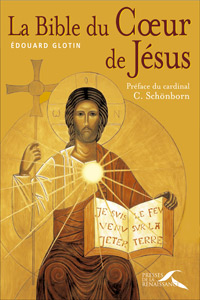
Edouard Glotin
Presses de la Renaissance
Notes et Annexes
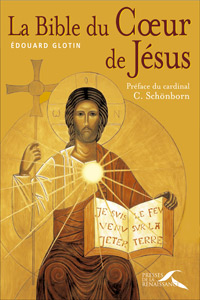 |
La Bible du Coeur de Jésus Edouard Glotin Presses de la Renaissance Notes et Annexes |
| Introduction Annexes • Haurietis Aquas • Le Coeur de Jésus et le Shabbat juif • Benoît XVI : Lettre au R.P. Kolvenbach (50° anniv. d'HA) • Benoît XVI : Message de Carême 2007 Commentaires des illustrations • Fig. 1 à 11 • Fig. 12 à 19 • Fig. 20 à 29 • Fig. 30 à 39 • Fig. 40 à 49 • Fig. 50 à 59 • Fig. 60 à 69 • Fig. 70 à 83 Notes • Prologue • Chapitre 1 • Chapitre 2 • Chapitre 3 • Chapitre 4 • Chapitre 5 • Chapitre 6 • Chapitre 7 • Chapitre 8 • Chapitre 9 • Chapitre 10 • Chapitre 11 • Chapitre 12 • Liste des sigles |
Notes du chapitre 12 Conscience du Christ et Cœur de Jésus
1. « Lui qui m’a aimé et s’est livré pour moi ». Les données du Catéchisme « Tous et chacun connus et aimés » « Pour nous les hommes et pour notre salut » L’arrière plan évangélique 2. @ Saint Jean et les synoptiques. Seul Matthieu et Jean ont eu l’observation personnelle des faits, Marc les a entendus maintes fois de la bouche de Pierre et Luc les a connus par une enquête historique auprès des témoins oculaires. En appliquant l’épithète traditionnelle de « spirituelle » à l’interprétation de saint Jean, je ne nie nullement que tout le Nouveau Testament soit une relecture spirituelle de l’événement de l’Incarnation à la lumière du mystère pascal (1). « Nous voyons que tu sais tout » 4. @ Traduction de Jn 2, 24-25. « Mais lui, Jésus, ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous lui-même… ». « Le verbe pisteuein, suivi de l’accusatif auton, ne s’applique pas ici à la foi. » (E. DELEBECQUE, Evangile de Jean, texte traduit et annoté, Cahiers de la Revue Biblique, n° 23, Paris, Gabalda, 1987, p. 149). Voir le dictionnaire Bailly, qui donne un exemple chez Plutarque. « Je connais mes brebis » Les enjeux spirituels « Je pensais à toi dans mon agonie » 9. @ Maurice Blondel et le Christ. Cf. l’article de J. Mouroux, « Maurice Blondel et la conscience du Christ » dans L’homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père H. de Lubac, T. III, Aubier, Paris, 1964, p. 185-207. 13. @ « La confession d’un exégète ». « Le troisième centenaire de la mort de sainte Marguerite-Marie devrait marquer un renouveau pour l’Eglise de France. Le moment semble venu d’avancer avec une intelligence et une détermination rajeunies sur le chemin ouvert, il y a trois siècles, par la sainte de Paray Le Monial. Bien des obstacles, et de taille ! avaient jusqu’il y quelques années – jusqu’à l’étonnante reprise du rayonnement de Paray, dont le point culminant fut la visite de Jean-Paul II en 1986 - empêché ce grand mouvement que l’on pouvait cependant pressentir. Je dirai quelques mots de ces obstacles. Mais aujourd’hui réapparaît avec une sorte d’évidence la puissance prophétique et sanctifiante du message que sainte Marguerite-Marie fut chargée de nous transmettre. La France a reçu ici, comme l’écrit le Père Glotin, « la spiritualité par excellence de la modernité ». Et je voudrais brièvement indiquer dans quel sens cela peut nous engager. Il faut bien voir les obstacles de toutes sortes qui, depuis un bon siècle surtout, ont retardé l’intelligence et la mise en œuvre de la Parole de Dieu qui fut ici même réveillée il y a trois siècles. Il y a bien sûr les obstacles extérieurs à l’Eglise, je veux dire ceux qui viennent d’intellectuels dont la recherche demeure limitée par des préjugés rationalistes et scientistes ou, à l’inverse, de visionnaires simplistes en qui triomphent les divagations sentimentales de la « folle du logis ». D’un côté je pense aux études réductrices de Michelet et James ou de certains psychanalystes modernes. Pris par le désir, en soi excellent, d’expliquer l’explicable, ils refusent la possibilité même de l’inexplicable ! Comme si toute rencontre un peu authentique de l’homme avec le Dieu vivant trois fois saint pouvait ne pas l’atteindre d’une manière inexplicable ! Ce qu’il est bon de rappeler ici, c’est que Marguerite-Marie, dont les visions, comme celles de tant d’autres saints et saintes, furent si étranges pour notre mentalité moderne, était aux dires des contemporains les mieux placés pour en juger, une femme particulièrement équilibrée. ‘Dieu lui avait donné beaucoup d’esprit, un jugement solide, fin et pénétrant’ écrit un Jésuite qui la rencontrait souvent. ‘Elle était naturellement judicieuse et sage et avait l’esprit bon, l’humeur agréable, le cœur charitable au possible’ témoignait Mère Greyfié, sa Supérieure de 1678 à 1684. C’est pourquoi d’ailleurs il est tout aussi faux et nuisible de se laisser impressionner par d’autres tendances qui tout en étant diamétralement opposées au rationalisme, n’en sont pas moins étrangères à l’esprit de l’Eglise. Fausses visions sans message vrai, sans témoignage d’humilité et de charité concrète, sans obéissance ! Pseudo-révélations éloignées de l’Evangile et de l’enseignement unanime des évêques ! Elles pullulent aujourd’hui et le succès des plus fausses empêche parfois des hommes de bonne volonté de se tourner vers les plus vraies, celles sur lesquelles l’Eglise s’engage, de nos jours par exemple pour Bernadette de Lourdes, hier pour Marguerite-Marie de Paray-le-Monial. Les obstacles internes à l’Eglise sont d’ailleurs les plus difficiles à vaincre pour nous car ils sont plus subtils et, d’une certaine manière, plus normaux, liés à la limite humaine plus encore qu’au péché. Je n’en énoncerai qu’un seul, paradoxal : l’extraordinaire succès de la spiritualité du Cœur de Jésus au siècle dernier a fini par se retourner contre elle ! Dès 1688, Marguerite-Marie avait pris l’initiative de demander à des Jésuites de faire connaître la dévotion au Sacré Cœur. Ainsi parurent très vite les premiers traités de la ‘Dévotion au Cœur de Jésus’, rédigés par les Pères Croiset et Froment, suivis par d’autres pendant le 18° siècle en France et à l’étranger, notamment au Liban, chez les Maronites, au Canada, en Chine, en Amérique Latine. Mais c’est au 19° siècle que la Compagnie allait organiser et réussir le développement universel de la pastorale du Cœur de Jésus. La fondation, à peu près en même temps que la Première Internationale Socialiste par Karl Marx, de l’Apostolat de la Prière, organisation planétaire de ce culte, par le Père Henry Ramière, connut un prodigieux succès et contribua d’admirable manière au renouveau de la ferveur catholique, en France et partout. C’est ici que se produit le paradoxe, inévitable, auquel je viens de faire allusion. La spiritualité du Cœur de Jésus fut un peu victime de son succès populaire. Il en allait d’ailleurs de même pour la dévotion à Marie. D’une part l’habitude risque toujours de voiler les raisons profondes qu l’ont fait naître. Parfois même elle les fausse. Telle est la pente sur laquelle glissaient assez souvent les dévotions collectives les plus chaleureuses. Le sentiment religieux qui les porte n’est plus alors assez purifié et éclairé par la foi. D’autre part, et à cause de cela, le lien avec des courants politiques ou des idéologies contingentes peut se resserrer et, éventuellement être exploité. Dans mon enfance, il l’était encore et certains cantiques de ce temps en l’honneur du Cœur de Jésus portent la marque d’un nationalisme fort peu évangélique ! Tout cela peut expliquer le recul pris, pendant quelques décennies, dans bien des séminaires, par rapport au message de sainte Marguerite-Marie. Mais voici qu’en quelques années, sans doute à cause de l’‘effet conciliaire’, des changements culturels, d’une meilleure connaissance de l’histoire et surtout, en tout cela d’ailleurs, de l’Esprit-Saint, ces obstacles se sont réduits. La voie est presque déblayée. Un étonnant renouveau s’annonce ! Je signerais volontiers cette phrase de Mgr Gaidon, évêque de Cahors. ‘Un jour viendra où l’on découvrira comment Dieu, par des chemins déconcertants et loin des projets pastoraux, a fait jaillir du Cœur du Christ, les torrents d’eau vive dont l’actuelle humanité a le plus urgent besoin ». Et je comprends aujourd’hui mieux qu’il y a quelques années certaines insistances discrètes mais très fortes des Papes dans leur enseignement sur la dévotion au Cœur du Christ. Cette dévotion manifeste, nous disent-ils, un point de notre foi tout à faire central, et même en quelque sorte le point central de notre foi. Dans son encyclique sur la Divine Miséricorde, Jean-Paul II écrit : ‘Nous approcher du Christ dans le mystère de son Cœur nous permet de nous arrêter sur un point, point central en un certain sens et en même temps le plus accessible au plan humain, de la révélation de l’amour miséricordieux du Père qui a constitué le contenu central de la mission messianique du Fils de l’Homme (D.M., 13). Le même Pape, en octobre 1986, à deux pas d’ici, disait aux révérends Pères Jésuites, en présence de leur Général, que ‘la dévotion au Sacré Cœur répond plus que jamais, aux attentes de notre temps’. Dévotion appuyée sur ‘le point central’, en quelque sorte, de notre foi, dévotion qui répond ‘plus que jamais’, aux attentes de notre temps, c’est ce que Pie XII avait appelé une ‘expression parfaite de la religion chrétienne’ (Haurietis Aquas, 1956). Pour ma part, je confesse que j’ai compris bien tard la portée de ces propos. Oui, il y a peu de temps que toutes les données sur le Cœur du Christ présentes d’une manière éparse à ma conscience se sont soudain unifiées. J’ai naguère enseigné, comme professeur d’exégèse, avec une réelle jubilation intérieure, les deux passages de l’Evangile selon saint Jean sur le côté ouvert du Seigneur en Croix et sur le don de sa Mère au Disciple qu’il aimait. Mais j’étais alors victime d’une sorte d’inhibition. Dans certains cours de L’Institut Biblique de Rome et de l’Ecole de Jérusalem, j’avais appris à ne rien dire, ou presque, qui ne s’appuie sur une argumentation critique sérieuse. Quelque chose en moi m’empêchait ainsi d’aller jusqu’au bout de la foi, sinon dans la contemplation personnelle, toujours présente, de l’eau et du sang sortant du côté transpercé, du moins dans mes cours. Il en allait d’ailleurs de même lorsqu’il s’agissait de Marie, sur laquelle je donnais un enseignement de type universitaire où je crois avoir bien parlé d’elle mais sans jamais m’adresser à elle, en tout cas jamais avec autant de tendre confiance et de lyrisme que nos frères d’Orient, dans les hymnes nées de leur foi, aussi populaires que doctrinalement sérieuses… Toutes proportions gardées et non sans quelque humour, je pourrais dire du Cœur du Christ ce que saint Augustin, dans ses Confessions, écrivait de la Beauté : ‘Je t’ai si tard aimée, ô Beauté qui m’appelait à grands cris !’. Désormais je vois, avec la force toujours naissante de l’intuition spirituelle, que la redécouverte, à travers un grand déblaiement des mots, des images et des comportements liés aux mentalités d’une époque, de l’essentiel du message de Paray-le-Monial, ouvre des voies nouvelles à la mission que l’Eglise a reçue du Seigneur. J’en indique deux, à titre d’exemple. L’une concerne la théologie et l’autre, la pastorale. Le temps est venu d’une théologie nouvelle. Ou plus exactement d’une théologie qui, intégrant toute la requête et tous les apports des sciences, ne cesse jamais, ne cesse pas un seul instant, de garder le cœur c’est-à-dire au sens biblique le fond de l’être ! - ouvert sur le Dieu vivant et vivifiant et ‘les yeux’ fixés sur ‘l’auteur de notre foi’ (He 12, 2) en son Mystère éternel, sur ‘ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui L’aiment’ (I Co 2, 9). Par un souci plus que légitime de fidélité, les théologiens modernes, encouragés d’ailleurs par les plus hautes instances de l’Eglise, ont produit un vigoureux effort critique et scientifique. Mais il est arrivé que cet effort fasse abstraction, pas seulement par méthode mais parfois par oubli et même par un refus plus ou moins conscient, de la source qui toujours jaillissante lui donne son véritable goût – recta sapere ! – et son véritable sens, lequel n’est jamais autre que ‘la foi cherchant à comprendre’. Nous en reviendrons bientôt à ce que le Père Lethel appelle la ‘théologie des saints’ et d’autres la ‘théologie à genoux’. Telle était l’inspiration de l’Eglise indivise, l’inspiration de tous les Pères, de saint Irénée à saint Bernard. ‘Si tu es théologien, tu pries en vérité et si tu pries en vérité tu es théologien’ disait Evagre le Pontique. Telle doit être toujours, par définition même, y compris pour une théologie devenue ‘scientifique’, l’orientation majeure de l’esprit du théologien à l’œuvre. ‘Puisque l’objet de la théologie, dit une instruction récente de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, est le Dieu vivant et son dessein de salut révélé en Jésus Christ, le théologien est appelé à intensifier sa vie de foi et à unir toujours recherche scientifique et prière’. Le théologien qui a redécouvert ‘le point central’ de la foi qu’est le Cœur du Christ ne peut plus pratiquer une autre théologie que celle des saints, une ‘théologie à genoux’. Mais vient aussi pour notre Eglise le temps d’un renouveau de la pastorale. Je pense parfois, en considérant le nombre et la diversité des organismes que l’Eglise de France s’est donnée depuis trente ans, leur complexité, leur relative étanchéité, l’affinement de leurs méthodes et le poids de leurs productions, que nous héritons d’un temps, pas si lointain, où le nombre considérable de prêtres, l’ampleur des communautés eucharistiques dominicales et le respect quasi instinctif de l’autorité épiscopale permettaient sans perdre l’unité vivante et le dynamisme unifiant de l’Eglise, d’user d’un instrument apostolique presque sophistiqué. Aujourd’hui, dans une situation très différente, nous maintenons ce système. J’ai entendu naguère le Cardinal Marty dire : ‘Il faudrait une commission de la hache !’. La redécouverte du ministère du théologien dont je viens de parler s’accompagne de la redécouverte de la nécessaire simplicité du ministère tout entier de l’Eglise ! Le Cœur de Jésus est simple et cette simplicité unifie toute l’action de notre Maître, si complexe, si fine et parfois si habile qu’elle soit. Le Cœur de notre Mère Marie est simple. En ce centre d’elle-même où ‘elle passe et repasse toutes ces choses’ comme dit saint Luc, sa prière, son action et toute sa vie s’unifient. Pensez au Magnificat. Pensez à Cana. Pensez au silence du Vendredi saint ! Redécouvrir le Cœur unique du Christ, redécouvrir le Cœur de Marie si proche du Cœur du Christ, c’est forcément simplifier le Cœur de l’Eglise, accroître cette ‘simplicité de la colombe’ à laquelle Jésus invite ses disciples. Quand l’eau et le sang, quand la source vive de l’Esprit et le feu de l’Amour Rédempteur donnent, par la foi de ceux qui les accueillent, leur unité à tous les membres et à toutes les activités du Corps infiniment varié du Christ, alors tout devient aisé, de l’aisance de l’Amour. Tout se simplifie. Le joug est doux, le fardeau léger. La grande joie sans rivage, ignorée du monde, la paix qui dépasse tout, inondent le cœur des enfants et des pasteurs de l’Eglise ! Oui, ce temps viendra et il est déjà là. Dans mon ministère quotidien j’entrevois, dans l’épaisseur parfois effrayante de la nuit, l’aurore de temps nouveaux où notre Eglise, rajeunie par le torrent d’amour jaillissant du cœur du Christ, montre à nos contemporains en quête du Dieu Inconnu le visage du Seigneur de Gloire crucifié (I Co 2, 8). Je pressens qu’ils se tournent vers Lui et reconnaissent Celui qu’ils ont transpercé (Jn 19, 37). Alors que s’annonce le troisième millénaire de notre ère, le troisième centenaire de celle que le Seigneur a appelée pour faire redécouvrir à l’Eglise la Révélation centrale du Cœur du Christ oriente, affermit et éclaire notre espérance. Voici que l’Eau Vive jaillissante rejoint le désir rajeuni ! Voici venir une nouvelle Pentecôte d’Amour ! » Albert Cardinal Decourtray, alors président de la Conférence épiscopale française, homélie dans la basilique de Paray-le-Monial pour le Tricentenaire de la mort de sainte Marguerite-Marie, le 14 octobre 1990, publiée dans Colloque 1990 (Darricau-Peyrous), 539-546. « J’ai versé telles gouttes de sang pour toi » 14. @ F.M. Dostoïevski, texte de L’idiot (III° partie, ch. 10). Le prince Mychkine est en train de lire une lettre de Nastassia Philippovna à Aglaia Ivanovna où la première dit toute son admiration pour la seconde, admiration qui prend la forme d’une idéalisation. « Qu’est-ce à dire ? (écrivait-elle encore). Hier, je suis passé près de vous et il m’a semblé que vous rougissiez ? C’est impossible ; il s’agit d’une apparence. Si l’on vous amenait dans le plus sordide des bouges et qu’on vous y montrât le vice nu, vous ne sauriez rougir : vous ne pouvez vous fâcher d’une offense. Vous pouvez haïr tous les gens bas et abjects, mais par sollicitude pour les autres, pour ceux qu’ils outragent, non par ressentiment personnel. Car vous, nul ne peut vous blesser. J’ai l’impression, voyez-vous, que vous devez même m’aimer. Vous êtes pour moi ce que vous êtes pour lui : un esprit de lumière ; or, un ange ne peut haïr, mais il ne peut pas ne pas aimer. Peut-on aimer tous les hommes sans exception, tous ses semblables ? Voilà une question que je me suis souvent posée. Certainement non ; c’est même contre nature. L’amour de l’humanité est une abstraction à travers laquelle on n’aime guère que soi. Mais si cela nous est impossible, il n’en va pas de même pour vous ; comment pourriez-vous ne pas aimer n’importe qui, alors que vous n’êtes au niveau de personne et qu’aucune offense, aucune indignation ne saurait vous effleurer ? Vous seule pouvez aimer sans égoïsme ; vous seule pouvez aimer non pour vous, mais pour celui que vous aimez. Oh ! qu’il me serait cruel d’apprendre que vous éprouvez, à cause de moi, de la honte ou de la colère ! Ce serait votre perte ; vous tomberiez du coup à mon niveau… « Hier, après vous avoir rencontrée, je suis rentrée chez moi et j’ai imaginé un tableau. Les artistes peignent toujours le Christ d’après les données de l’Evangile ; moi je l’aurais figuré autrement. Je l’aurais représenté seul, car, enfin, il y avait des moments où ses disciples le laissaient seul. Je n’aurais placé auprès de lui qu’un petit enfant. Cet enfant aurait joué à ses côtés ; peut-être lui aurait-il raconté quelque chose dans son langage ingénu. Le Christ l’a d’abord écouté, mais maintenant il médite. Sa main repose encore, dans un geste d’oubli involontaire, sur les cheveux clairs de l’enfant. Il regarde au loin, vers l’horizon ; une pensée vaste comme l’univers se reflète dans ses yeux ; son visage est triste. L’enfant s’est tu ; accoudé sur les genoux du Christ et la joue appuyée sur sa petite main, il a la tête levée et le regarde fixement, de cet air pensif qu’ont parfois les tout petits. Le soleil se couche... ; Voilà mon tableau ! » 2. « Vous, vous êtes d’en bas, Moi, je suis d’en haut ». Le problème Croire pour comprendre 17. @ L’expression abba et le rapport filial unique de Jésus au Père. B. FORTE, Jésus de Nazareth, Cerf, Paris, 1984, p. 188-190. L’auteur se réfère à J. JEREMIAS, Abba. Jésus et son Père, Paris, Seuil, 1972 ; J. JEREMIAS, Théologie du Nouveau Testament, Cerf, Paris, 1973 ; W. MARCHEL, Abba, Père. La prière du Christ et des chrétiens, Roma, 1971. Cf. aussi l'étude de J. SCHLOSSER, Le Dieu de Jésus. Etude exégétique, LD, Cerf, 1987 ; J. GALOT, La conscience de Jésus, Duculot-Lethielleux, 1971, p. 11-91 ; IBID, Christ, Qui es-tu ? Louvain, Sintal, 1986, p. 114-119. Comprendre pour croire 19. @ La crise moderniste. Dans l’approche du mystère du Christ, on observe comme un renversement par rapport à la problématique des théologiens du Moyen-Age. Au Moyen-Age, l’évidence du Christ vrai Dieu s’imposait, tandis que la mise en lumière de la science acquise de Jésus a été laborieuse. Au XIX° siècle inversement, la tendance est à revendiquer la pleine humanité du Christ homme et à passer au crible ce qui dépasse sa condition humaine au risque d’amoindrir l’élévation due à l’union hypostatique. D’un côté, une christologie « descendante » ; de l’autre, une christologie « ascendante ». Cf. E. POULAT, Histoire, dogme, et critique dans la crise moderniste, Paris, Casterman, 1979, p. 485-511. Noter dans le climat polémique de l’époque la position « défensive » de l’Eglise par les Décrets du Saint Office de 1907, Lamentabili (D 3434) et de 1918 (D 3645-3647). Au cœur de la crise moderniste, le philosophe français Maurice Blondel essaiera en toute honnêteté intellectuelle d’honorer la démarche de la rationalité moderne. Il réussira à mettre en lumière dans une authentique recherche philosophique l’exigence d’un accomplissement de l’Action par une intervention grâcieuse de l’Absolu, dans un ordre surnaturel à travers la figure d’un Médiateur universel. Cf. L’Action, essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique, Paris, PUF, 1893 (1° édition). La solution 20. @ Le plan de travail de la Commission théologique internationale sur la conscience du Christ. Le travail de la Commission théologique internationale s’est subdivisé en deux questions : “Quel est le contenu des ‘sciences-connaissances’ du Christ, Dieu et homme?”, d’une part ; “Quel est le statut psychologique et ontologique de celles-ci ?”, d’autre part. “Pour reprendre l’ancienne terminologie technique, on a pu dire : ‘Quid scitur a Iesu Christo’ ? ‘Quomodo haec cognoscuntur a Verbo Incarnato’?” (CTI 1985, p. 916). Seule la première partie du travail a abouti à la publication de quatre propositions (Commission théologique internationale, 8 / 12 / 1985 : « La conscience humaine de Jésus », DC, 1926 (1986), p. 916-921). La seconde partie est restée à l’état de document de travail (Instrumentum laboris) et a été publiée sous sa propre responsabilité par le père Schönborn (« La conscience du Christ. Approches historico-théologiques », publié par C. VON SCHÖNBORN dans Esprit et Vie, 9 02 1989, p. 81-87). Un Jésus qui « savait tout » ? 21. @ Jn 3, 34. « celui que Dieu dépêcha, il dit les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l’Esprit » (trad. E. DELEBECQUE, L’Evangile de Jean, Paris, Gabalda, 1987). « celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, qui lui donne l’Esprit sans mesure » (TOB). « celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l’Esprit sans mesure » (BJ). « Celui que Dieu a envoyé parle en effet le langage de Dieu, car [il = Dieu ou le Fils] ne donne pas l’Esprit avec mesure » (Osty). Selon Feuillet, c’est intentionnellement que Jean laisse indéterminé le sujet pour indiquer que le don de l’Esprit provient conjointement du Père et du Fils. A. FEUILLET, Le mystère de l’amour divin dans la théologie johannique, Gabalda, 1972, p. 43-46. 22. @ L’embarras de la Tradition au sujet de l’interprétation de Mc 13, 32. 1. Avant la crise agnoète. La question de la science du Christ est étroitement liée, chez les pères, au texte de Mc, 13, 32 : « Quant à la date de ce jour, ou à l’heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père ». Avant la crise agnoète du VI° siècle, de nombreux Pères affirment que le Christ connaît tout comme Dieu, mais peut ignorer dans son humanité ; ainsi, Irénée, Origène, Athanase ou Cyrille d’Alexandrie. A propos de Saint Cyrille d’Alexandrie, le Père Lebreton précise : « la science divine du Verbe est infiniment parfaite, et le Christ eût pu la manifester, dès l’origine et en toute occasion, dans son humanité ; mais, s’étant fait semblable à nous il a voulu partager nos infirmités : il a donc voulu que le développement de son intelligence apparût progressif comme celui de son corps, et il a voulu aussi se montrer, en certaines occasions, comme ignorant, de même qu’il a voulu souffrir de la faim et de la soif. Dans cet énoncé, pour serrer de plus près la pensée de saint Cyrille, nous avons tenu à représenter cette ignorance comme apparente, comme extérieure, ainsi que le saint docteur le fait lui-même le plus souvent ; mais nous ne pensons pas que par là il veuille signifier une feinte ou un faux-semblant : dans cette hypothèse on ne pourrait comprendre le dessein miséricordieux du Christ, sur lequel il insiste tant (‘il a voulu prendre toutes nos infirmités pour les guérir toutes’) et l’on ne pourrait non plus s’expliquer ce rapprochement de la croissance physique du corps avec le développement progressif de l’intelligence. On interprétera plus exactement cette doctrine en concevant, d’après saint Cyrille, cette ignorance humaine comme réelle, mais comme étant, pour ainsi dire, à la surface de la vie du Christ ; quiconque pénétrera plus avant, rencontrera la divinité et sa science infinie ; cette ignorance n’est qu’une forme extérieure (schèma en grec) ; mais l’humanité du Christ est appelée de même par saint Cyrille, et dans ces mêmes passages schèma anthrôpinon (PG 75, 429B). En reprenant cette expression, que saint Paul avait consacrée (Phil 2, 7), saint Cyrille n’entend certes pas mettre en question la réalité de l’humanité du Seigneur, mais montrer qu’il y a en lui, sous les dehors de cette humanité, une autre nature plus intime, plus profonde ; c’est dans le même sens qu’il écrit : ‘le Christ attribue l’ignorance à son humanité, et non pas à sa propre nature (PG 75, 373A). L’humanité du Christ est, avant tout, pour lui, l’instrument dont se sert le Verbe (PG 75, 429C) et par lequel il révèle sa divinité (428B) ; à son gré, il y manifeste l’ignorance propre aux hommes, ou il y fait transparaître la science d’un Dieu » (2). 2. Le Concile de Chalcédoine et la crise agnoète. On observe un rejet de l’ignorance chez le Christ dans son humanité par réaction contre le nestorianisme. Témoin, cette condamnation par le pape Vigile (553) d’une proposition teintée de nestorianisme : « Si quelqu’un dit que l’unique Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu et vrai Fils d’homme, était dans l’ignorance de l’avenir ou du jour du jugement dernier, et qu’il n’a pu savoir que ce que la divinité habitant en lui comme dans quelqu’un d’autre lui révélait, qu’il soit anathème » (D 419). L’ignorance est conçue le plus souvent comme blâmable, conséquence et source du péché, liée à notre état de nature déchue. On conçoit difficilement une ignorance moralement neutre liée à une croissance du Christ selon la parole de Lc, 2, 52 : « Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». De saint Augustin : « On dit que Dieu sait lorsqu’il fait savoir ; quand on dit qu’il ignore, cela peut signifier qu’il estime opportun de laisser ignorer ce qu’il n’est pas opportun de savoir. Aussi faut-il entendre exactement le texte : ‘le Père seul sait’ comme signifiant qu’il le fait savoir au Fils et le texte ‘le Fils l’ignore’ comme signifiant qu’il le fait ignorer aux hommes, entendons : qu’il ne leur dévoile pas ce qu’il ne leur est pas expédient de savoir » (De diversis Quaestionibus, 83, Qu 60, RJ 1555). On appellera « ignorance économique » le refus de Jésus de révéler ce qu’il n’avait pas mission de révéler. Grégoire le Grand, s’inspirant d’Augustin, condamne les agnoètes et Thémistuis dans une lettre à Euloge d’Alexandrie, à la fin du VI° siècle. Les agnoètes attribuaient l’ignorance du jour et de l’heure du jugement à l’âme humaine du Christ. « Le Fils tout-puissant dit qu’il ignore le jour que lui-même fait ignorer, non qu’il l’ignore, mais parce qu’il ne permet absolument pas qu’on le connaisse… le Fils unique incarné, fait pour nous homme parfait, a connu le jour et l’heure du jugement dans la nature humaine, et ne l’a pourtant pas connu de par la nature humaine. Ce qu’il a donc connu en elle, il ne l’a pas connu par elle, car c’est par la puissance de sa divinité que le Dieu fait homme a connu le jour et l’heure du jugement… (D 474-475). Maxime le Confesseur reconnaît l’omniscience relative de Jésus en son humanité. Le Christ comme homme sait tout non par nature mais à cause de l’union à la nature divine dans le Verbe. Sur la question de l’ignorance et de l’omniscience du Christ en sa nature humaine chez Maxime, cf. J.C. LARCHET, La divinisation de l'homme selon Saint Maxime le Confesseur, p. 309-312 et dans la traduction de Th. Pol. par E. PONSOYE, p. 70-71. Notons que Maxime semble distinguer une ignorance non blâmable qui peut être attribuée au Christ en son humanité. Néanmoins, concrètement, du fait de l’union hypostatique, la nature humaine reçoit la connaissance de toute chose. Jean Damascène : « il devint parfait dans la science humaine et divine dès le premier instant de sa conception » (Traité sur les deux volontés, PG 95, 177 BC). « la nature humaine que le Verbe a assumée est ignorante, et ne connaît pas l’avenir, néanmoins, à cause de l’identité de la personne du Verbe et de l’inséparable union (des deux natures), l’âme du Seigneur a été enrichie de la connaissance des choses à venir « (Foi orthodoxe, III, 21, PG, 94, 1084). Nous voyons ici émerger le thème de la connaissance de Dieu par le Christ dès le premier instant de sa conception. Le même thème se retrouve chez Saint Anselme, Pourquoi Dieu s’est fait homme ? SC 91, p. 399 et sera développé par Saint Bernard, (PL 183, 65-66). En somme, tout comme dans le mouvement du Concile de Nicée, on avait mis en évidence la science divine infinie du Verbe de Dieu, dans le mouvement du Concile de Chalcédoine, l’Eglise prendra une conscience toujours plus vive de la science humaine du Christ qui participe à sa mesure de l’omniscience divine. Cf. DTC, art. « Science de Jésus Christ », col 1639 et sv ; J.P. TORRELL dans ST, Le Verbe incarné, T II, Cerf, Paris, 2002, « La science du Christ », 416-421 ; le dossier patristique de l’Instrumentum laboris : « La conscience du Christ, approches historico-théologiques », publié par C. VON SCHÖNBORN, Esprit et Vie, 9 février 1989, 81-83. Voir aussi B. de MARGERIE, « Les sept yeux de l’agneau. Reprise du dossier sur la science humaine de Jésus avant Pâques », Divus Thomas, LXXXVI (1983), n°1, p. 15-28. 23. @ Jésus et la date du jugement dans CEC 474. CEC 474 renvoie aux deux textes où Jésus aborde la question (Mc 13, 32 et Act 1, 7), sans remettre en cause explicitement l’interprétation dominante de l’Eglise depuis Grégoire et Augustin (« ignorance économique »). Il n’est peut-être cependant pas impossible de distinguer dans CEC 474 deux temps dans la conscience du Christ par rapport au jugement : - Avant la résurrection, le Christ « reconnaît ignorer » parce qu’il n’aurait pas la connaissance ; CEC cite Mc 13, 32. - Après la résurrection, le Christ « déclare…n’avoir pas mission de… révéler », ce qui sous entendrait qu’il possède désormais la connaissance ; CEC cite Act 1, 7. 24. @ Interprétations actuelles de Mc 13, 32 à la lumière de Jean. La plupart des commentateurs actuels admettent que Jésus a réellement ignoré le jour du jugement dans sa connaissance humaine. Guillet semble suivre cette hypothèse, bien qu’il ne l’appuie pas sur Jn. Cf. J. GUILLET, Jésus devant sa vie et sa mort, Paris, Aubier-Montaigne, 1971, 194-195. C’est en tout cas l'opinion de F. Dreyfus qui s’appuie sur les arguments thomistes de JH Nicolas. (F. DREYFUS, Jésus savait-il qu’il était Dieu, p. 122-123). « Jésus de Nazareth dispose de la connaissance qu’il possède en tant que Verbe de Dieu égal au Père. Mais rien ne dit qu’il dispose de toute la connaissance du Verbe. Il y a une limitation clairement exprimée en Jean 15, 15 : ‘Tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître’. Donc ce que Jésus a fait connaître aux disciples est limité » (F. DREYFUS, op. cit. p. 123). 25. @ ST Supplément, Qu 88, art. 3. A propos de la date et du lieu du jugement général, saint Thomas affirme, dans la ligne de l’interprétation commune depuis saint Grégoire : « Le Christ ne le sait pas en ce sens qu’il ne nous le fait pas savoir ». Mais par ailleurs : « Dieu est cause des choses par sa science. Il communique aux créatures soit la puissance de produire d’autres choses dont elles sont causes, soit la connaissance des autres choses. Dans ces deux sortes de communications, il se réserve certains pouvoirs. En effet, il accomplit certaines choses sans aucune coopération de créatures, et il connaît aussi certaines choses qu’il ne communique à aucune pure créature. Parmi celles-ci, il n’y en a pas qui doive être plus secrète que celles qui dépendent du seul pouvoir divin, sans aucune coopération de créature. Telle est la fin du monde, avec le jour du jugement. Le monde en effet finira sans l’action d’aucune cause créée, de même qu’il a été commencé par l’action immédiate de Dieu. Il convient donc que la connaissance de la fin du monde soit réservée à Dieu seul. C’est cette raison que le Seigneur lui-même semble apporter quand il dit : ‘Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a placés en son pouvoir’, comme pour signifier : qui sont réservés à son seul pouvoir ». Un Jésus qui « croyait » ? 28. @ Le « malaise culturel » qui aboutit à la crise moderniste. Témoin, ce passage de Loisy auquel renvoie le décret du Saint Office de 1907, Lamentabili (D 3434) : « La critique ne pourrait lui attribuer une science sans bornes que dans une hypothèse historiquement inconcevable et déconcertante pour le sens moral, en admettant que le Christ, comme homme, avait la science de Dieu et qu’il a délibérément abandonné ses disciples et la postérité à l’ignorance et à l’erreur sur quantité de choses qu’il pouvait révéler sans le moindre inconvénient (A. LOISY, Autour d’un petit livre, Paris, 1903, p. 138-139). Notons que Loisy se trompe en attribuant au Christ une science divine. 30. @ Peut-on parler d’une foi du Christ ? Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la foi de Jésus. J. Galot étudie des expressions de Paul ou de l’épître aux Hébreux qui pourraient être mal comprises. « Le fait que le Nouveau Testament ne parle pas de la foi du Christ ne pourrait être minimisé. Il y a là un aspect de la révélation qui mérite toute l’attention du théologien lorsqu’il veut pénétrer les secrets des dispositions intimes de Jésus » (p. 148). « Jésus n’a pas la foi mais suscite la foi » (p. 149). (J. GALOT, « Problèmes de la conscience du Christ. II. La conscience du Christ et la foi », Esprit et vie, 11 mars 1982, p. 145-152). Pour saint Thomas, le Christ n’a pas eu la foi, « adhésion à des vérités qu’on ne voit pas » (IIIa, Qu 7, art. 3). Il n’a pas eu non plus l’espérance (spes) en tant que vertu théologale, qui concerne Dieu lui-même, « attente de ce qu’on ne possède pas encore » (IIIa, Qu 7, art. 4). « Il a eu cependant l’espérance de certaines réalités qu’il ne possédait pas encore ; bien qu’il n’ai pas eu la foi à l’égard d’aucune d’entre elles… comme l’immortalité ou la gloire de son corps ; il pouvait donc les espérer » (IIIa, Qu 7, art. 4). C’est peut-être au niveau de cette « espérance » que l’on pourrait parler de la « confiance » (fiducia) du Christ en Dieu, terme dont le sens n’est pas très explicite et qui navigue entre la foi et de l’espérance lorsqu’il est employé pour nous. Le CEC l’emploie souvent pour désigner l’attitude du chrétien mais jamais, semble-t-il, pour parler d’une attitude du Christ envers son Père. Jean Paul II l’emploie 2 fois dans NMI 25 à propos de l’agonie et du cri de Jésus en croix. On pourrait dire : notre foi se fonde sur la vision de Jésus. Notre confiance obscure en Dieu se fonde sur une « confiance » lumineuse de Jésus en son Père, adhésion (cohésion profonde et consentement pour reprendre les termes de Maxime) du Cœur du Christ au Père, obéissance malgré la difficulté, attente sûre du salut à venir. H. Urs von Balthasar (La Dramatique divine, II, 2, p. 136, note 10), renvoie à H. de Lubac (Augustinisme et Théologie moderne), pour soutenir la position de son livre : La foi du Christ. Cf. ci-dessous. Mais bien qu’il y ait une continuité entre l’élan de foi et la vision, ces textes n’impliquent pas, à notre sens, une foi dans le Christ : Pour Augustin, la foi : « croyance obscure fondée tout entière sur un témoignage extérieur et, de surcroît, portant tout d’abord essentiellement sur les faits salutaires qui se sont déroulés dans le temps ». Alors « la contemplation infuse ou la ‘vision’ exclut la foi » (H. de Lubac, Augustinisme et Théologie moderne, Aubier, Paris, 1965, p. 128-129). Adam intègre n’avait pas cette foi. Pour saint Thomas, « la foi définit surtout un certain état de l’intelligence qui exclut l’autonomie rationaliste sans atteindre à la plénitude de la vision béatifique » (Ibid. p. 129). Alors, Adam intègre avait la foi. « Tout en soulignant l’intériorité de la connaissance de foi, ‘acte intellectuel étrange et essentiellement imparfait’, sur le plan rationnel « Si l’on renonce à la vision béatifique et si l’on suit la logique de la démarche thomasienne, il faut que le Christ ait eu la foi… s’il n’a pas la vision, il doit donc avoir la foi. En thomisme, il n’y a pas de moyen terme » (J.P. TORRELL, « Saint Thomas d’Aquin et la science du Christ », p. 403). Pour une confrontation entre Balthasar et saint Thomas d’Aquin, cf. H. DONNEAUD, "Hans Urs von Balthasar contre saint Thomas d'Aquin sur la foi du Christ", Revue Thomiste, 1997, p. 335-354. 31. @ Ignorance et liberté. « Jésus est un homme authentique et la noblesse inaliénable de l’homme est de pouvoir, de devoir même projeter librement le dessein de son existence dans un avenir qu’il ignore… Priver Jésus de cette chance et le faire avancer vers un but connu d’avance et distant seulement dans le temps, cela revient à le dépouiller de sa dignité d’homme » disait radicalement Balthasar, dans un texte dont la force de protestation a marqué durablement les esprits. (H. URS VON BALTHASAR, La foi du Christ, Paris, 1968, 181). Plus nuancé, Rahner affirmait : «… une philosophie de la personne et de la liberté de l’être fini, de l’histoire et de la décision pourrait montrer assez facilement qu’il est nécessaire à la personne finie (3) pour qu’elle se réalise dans une option libre, historique, d’avoir une marge de risque, de s’avancer dans l’inconnu (le mystère), de compter sur l’imprévisible, d’accepter (l’obscurité) des origines et l’obscurité des fins, donc une certaine manière d’ignorance…Une certaine ignorance, condition nécessaire pour que la liberté de la personne finie s’exerce au cours du drame de son histoire, est quelque chose de plus parfait que le savoir dans cet exercice de la liberté, car ce savoir neutraliserait cet exercice ». (K. Rahner, « Considération dogmatique sur la psychologie du Christ » dans l’ouvrage collectif Exégèse et dogmatique, DDB, Paris, 1966, p. 196). Une telle conception de la liberté est cependant loin d’être incontestable. La science n’étouffe pas forcément une liberté vraie… Peut-être ces positions sont-elles marquées par un certain « existentialisme » ambiant… Quoi qu’il en soit, les conditions d’exercice de la liberté de l’homme de notre sorte, ne s’appliquent pas au Christ telles quelles, à moins d’en faire un « pur homme ». Il est sans doute nécessaire d’admettre une « nescience », ignorance non blâmable comme condition d’exercice de la science acquise chez Jésus (4) ; Jésus qui interroge, qui apprend, qui s’étonne… Mais, du fait de son union à la nature divine dans la Personne du Verbe, la connaissance humaine acquise de Jésus était élevée à un mode d’exercice supérieur (5). Ce que nous avions affirmé avec Maxime le Confesseur de l’union des deux volontés, il nous faut par conséquent aussi l’affirmer au niveau du rapport de l’intelligence humaine et de l’intelligence divine. Maxime avait mis en valeur l’accord profond de la volonté humaine et de la volonté divine tant sur le plan des natures que sur le plan de l’action libre ; nous pourrions dire en utilisant ses termes que l’intelligence humaine du Christ était divinisée. La connaissance humaine du Christ ne s’en trouve pas altérée dans sa nature, mais elle est élevée à un mode (tropos) nouveau d’existence grâce à l’union hypostatique. Le Nouveau Catéchisme cite d’ailleurs le Père grec pour confirmer son exposé. « La nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu » (Quaestiones et dubia, I, 67, PG 90, 840, cité en CEC 473). Maxime avait montré qu’une authentique autodétermination libre pouvait exister sans que la volonté humaine du Christ ait à passer par la délibération (gnômè), la recherche incertaine, l’ignorance, le doute, le tâtonnement vis-à-vis du bien recherché et, bien sûr, sans complicité avec le mal. Nous pourrions dire qu’une authentique liberté humaine peut aussi exister chez le Christ alors que son intelligence humaine est illuminée par une connaissance supérieure qui ne supprime pourtant pas la démarche humaine d’une connaissance acquise. Sur le mode d'exercice de la volonté et de la connaissance du Christ en leur statut constitutivement instrumental, cf. J-M. GARRIGUES, "L'instrumentalité rédemptrice du libre-arbitre du Christ chez saint Maxime le Confesseur", Revue Thomiste, 104, 2004, p. 531-550 et "La conscience de soi telle qu'elle était exercée par le Fils de Dieu fait homme", Nova et Vetera, mars 2004, p. 39-51. 32. @ La Trilogie de Balthasar. Il s’agit des trois parties de sa grande synthèse théologique : La Gloire et la Croix, Paris, Cerf/DDB, 1993 (réédition) ; La Dramatique Divine, Bruxelles, Lessius, de 1984 à 1993, La Théologique, Bruxelles, Lessius, de 1994 à 1997. 34. @ Le Christ fondateur de notre foi en He 12, 2. “Archègos signifie non pas proprement un pionnier qui donne l’exemple, mais un pionnier qui fonde une réalité nouvelle, un initiateur qui est le principe de cette réalité.” (J. GALOT, « Problèmes de la conscience du Christ. II. La conscience du Christ et la foi », Esprit et vie, 11 mars 1982, p. 148). Cf. A. VANHOYE, Situation du Christ. Epître aux Hébreux I et II, Paris, Cerf, 1969, p. 314-315. Non, un Jésus qui « aime » 39. @ A propos du livre de Dreyfus. Entretien avec le père Philippe Mercier. En écrivant son livre, François Dreyfus avait conscience de s’engager (6), au risque d’aller « à contre-courant des tendances dominantes de l’exégèse contemporaine » (7). Bien qu’écrit pour des non-spécialistes, des justificatifs viennent appuyer en notes les assertions de l’auteur. Bernard Sesboüé a fait du livre une recension assez critique (8) qui ne représente pourtant pas le point final de sa pensée. En effet, B. Sesboüé travaillera notamment au document adopté par la Commission Théologique Internationale en 1985 (9) et même à l’Instrumentum Laboris (10), deux documents qui vont plus loin que la position assez restrictive qu’il semble adopter dans cette recension. On ne saurait en revanche s’étonner de la recension très critique de Marie-Émile Boismard (11), alors compagnon de F. Dreyfus à l’École Biblique de Jérusalem. Nous avons demandé au Père Philippe Mercier, professeur d’Écriture Sainte à la Faculté de théologie de Lyon, élève à l’École Biblique de Jérusalem au temps de cette discussion, d’abord orale entre les deux hommes, de revenir sur ce point, plus de vingt ans après. Ce qui suit est une reprise de l’entretien que nous avons eu avec lui. Cet entretien a été relu par le Père Mercier qui a bien voulu nous autoriser à le publier ici. Lorsque l’on pose la question : « Jésus savait-il qu’il était Dieu ? », une bonne méthodologie nous invite à distinguer plusieurs entrées ou stades de questionnement : 1re entrée : celle du dogmaticien. La réponse à la question est : oui. Les conciles affirment que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme, consubstantiel à Dieu et consubstantiel à l’homme. Pleinement Dieu et pleinement homme. Or, avoir pleine humanité, c’est savoir qui nous sommes. Nous savons bien qui nous sommes ; on ne peut refuser cela à Jésus. 2e entrée. Qui va répondre à la question ? L’historien ? Ce que l’historien peut dire de Jésus est limité. Il ne peut dire : Jésus-Christ savait qu’il était Dieu. C’est le croyant qui va pouvoir répondre : Jésus savait qu’il était Dieu, en étant bien conscient que la foi est au-delà de la démonstration. 3e entrée. À partir de quoi vais-je pouvoir pressentir que Jésus savait qu’il était Dieu ? À partir des Écritures néotestamentaires qui rapportent les faits et gestes de Jésus. 4e entrée. Dans les évangiles pris canoniquement, il serait bon de distinguer : - Ce que les témoins disent de Jésus. Ex : le centurion qui dit : « vraiment, cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15, 39). « Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 41). Sous entendu, il n’y en a qu’un : Dieu ! - Ce que Jésus dit de lui-même, d’après les témoins. Quand Jésus parle de lui-même, il se réfère à Dieu son Père. Jésus ne nous a pas laissé une introspection de lui-même, mais par des expressions comme : « le Fils de l’homme (12) est maître, même du sabbat » (Mc 2, 28), nous avons accès à ce que Jésus pensait de lui-même. On saisit ce que Jésus savait de lui-même comme « en oblique ». Il semblerait que Boismard et Dreyfus ne distinguent pas suffisamment ces deux plans. 5e entrée : Le “détour” par les Écritures. Le rôle des Écritures juives dans la confession que les disciples font de Jésus. Ce qu’ils rapportent de Jésus leur est suggéré à la fois par leur connaissance de la première Alliance et par ce que Jésus a dit et fait. Le rôle des Écritures dans l’enseignement de Jésus lui-même. On peut dire que Jésus prend conscience de lui-même en se référant aux Écritures. Dans l’Écriture, Dieu ne dit pas qu’il est Père, il dit qu’il a un fils : « Tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur (Yhwh) : Mon fils premier-né c’est Israël » (Ex 4, 22), et le fils, c’est celui qui assure la gloire du Père. En Jean ch. 5 et 8, on voit bien que dans ses paroles, Jésus parlait comme un juif. En ce sens, tout fils d’Israël pouvait se considérer comme fils du Père. Plusieurs lieux du Talmud parlent du Seigneur Dieu en le désignant comme : « Votre Père des cieux » ou « Notre Père des cieux ». Cependant, les contemporains ont bien pressenti que lorsque Jésus disait : « le Père » ou « mon Père » une telle appellation allait plus loin que la filiation d’adoption. La discussion qui suit la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda semble bien témoigner de cela : « Et voilà pourquoi, les juifs persécutaient Jésus, parce qu’il faisait cela un Sabbat. Mais Jésus leur répondit : Mon Père est à l’œuvre jusqu’à présent et moi aussi j’œuvre. Voilà donc pourquoi les juifs n’en cherchaient que davantage à le tuer, parce que non seulement il violait le Sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu » (Jn 5, 16-18). S’il appelle Dieu « son propre père » (Jn 5, 18), le terme idios paraît pouvoir être compris comme employé par le Fils de Dieu en un sens unique et transcendant. Il est à noter qu’une telle parole est révélatrice de ce que les gens qui écoutaient Jésus pensaient de son identité. Par ailleurs, pourquoi Jésus aurait-il guérit un jour de Sabbat ? Or, il importe à la foi chrétienne de savoir que Jésus a guéri le jour du Sabbat. Loin de violer le Sabbat (comme il est dit que certains de ses contemporains le pensent) il l’achève, il mène le Sabbat à sa plénitude de sens. Et pour toute la mentalité juive de l’époque, à commencer par les évangélistes, seul Celui qui est l’instaurateur du Sabbat (Gn 2, 1-3) peut le faire. Au fond, il apparaît, surtout en lisant saint Jean, que Jésus est d’abord Fils, extrêmement Fils. Il est tellement Fils que le lecteur/auditeur des Écritures est amené à confesser sa divinité. On pourrait distinguer : - la filiation qui dit pour chacun de nous, notre origine en Dieu, filiation adoptive, - et la “filialité” qui n’est pas tellement le rapport de provenance du Père que l’être même de Fils. Car sinon comment comprendre la parole à première vue énigmatique : « Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi » (Jn 14, 28). En disant cela, Jésus reconnaît avoir le Père pour origine et se faisant il se comporte en fils (“filialité”). Cela n’altère pas la dignité divine (en langage théologique on dira la nature divine) que le Père lui donne de toute éternité en l’engendrant. Ce cadre étant posé, examinons quelques points de litige entre Boismard et Dreyfus : À propos de l’expression « Fils de Dieu », employée parfois par les témoins mais que Jésus ne s’applique pas à lui-même (13). L’expression ‘fils de Dieu » est ambiguë. Dans son sens premier, elle veut dire : « dans l’intime proximité de ». Par exemple : « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Qui était « fils de Dieu » ? Le roi d’Israël : « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » (2 Sam 7, 14), et Israël lui-même (Ex 4, 22) : « Mon fils premier né, c’est Israël ». « Fils de Dieu » n’a pas d’emblée le contenu que va lui donner le Concile de Chalcédoine, mais veut dire : fils de Dieu par adoption. En ce sens, Boismard a raison dans sa critique (p. 593-595). En général, les exégètes distinguent des lieux où « Fils de Dieu » a ce sens premier et des lieux où il peut cependant prendre un sens transcendant. Ainsi par exemple : « Il sera appelé Fils du Très Haut » (Lc 2, 32). L’usage de ce qu’il est convenu d’appeler le “passif théologique” (14) semble plutôt indiquer un sens transcendant. De même : en Marc 1, 1 : « Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Ici, Marc confesse la foi. En Jean 20, 31, contrairement à ce que dit Boismard (p. 593-595), il semblerait bien que « Fils de Dieu » ait un sens transcendant. D’abord, parce que ce verset conclut solennellement l’évangile de Jean et semble faire écho au Prologue. D’autre part, Jésus est dit « Messie » (15), c’est-à-dire celui qui a reçu l’onction, comme le roi d’Israël qui était ainsi établi fils par adoption, au contraire des pharaons d’Égypte qui prétendaient descendre de Dieu par filiation charnelle. Mais Jean prend la peine de rajouter « le Fils de Dieu » (avec l’article défini). Comme Messie dit déjà « fils de Dieu » par adoption, cela laisse entendre que « Fils de Dieu » veut dire ici plus. Les expressions de Phil 2, 9-11 ont elles un sens transcendant ? Ici encore, Boismard et Dreyfus s’opposent. Par exemple sur l’expression : « fléchir le genou » (p. 597 et 601). D’autre part, le titre de kurios (Seigneur), donné à Jésus évoque-t-il le Nom par excellence de Dieu ? Dans l’Écriture, chacun sait que l’on ne prononce pas le nom divin Yhwh (Tétragramme), mais qu’on le remplace par « Adonay », titre révérenciel, traduit ensuite en grec par Kurios (Seigneur). Boismard, au contraire de Dreyfus, estime qu’il n’y a pas équivalence entre Seigneur et le Nom ineffable de Dieu (p. 597-599). Selon le P. Mercier, le « nom au dessus de tout nom » (Phil 2, 9) revêt ici un sens transcendant, tout comme par exemple la mention en Lc 2, 11 de « Seigneur » à côté de « Sauveur » et de « Messie ». Le débat porte aussi sur le lien entre la préexistence du Christ (Phil 2, 6-7 ; I Co 8, 6 ; II Co, 8, 9 ; Col 1, 16-17…) et sa divinité. Dreyfus pense qu’il y a implication entre préexistence et divinité. Boismard va s’efforcer de montrer que les textes qui parlent de la préexistence du Christ peuvent être interprétés dans la ligne des écrits de Sagesse, sans impliquer la divinité du Christ. « Or, dans la perspective sapientielle, cette préexistence n’impliquait pas ‘divinité’…Cette logique n’était pas celle des auteurs des livres sapientiaux ; pour eux, bien qu’au principe de l’œuvre créatrice, la Sagesse avait été créée par Dieu » (p. 300). D’après Boismard, des textes comme Ap 3, 14 et Col 1, 15-16 sont expliqués par Prov 8, 22 (16). L’auteur va jusqu’à dire : « Il était donc possible de concevoir le Christ à la fois comme principe de la création et comme ayant été lui-même créé par Dieu, et donc comme ‘non-Dieu’ » (17). Mais une thèse si radicale reflète-t-elle bien les idées des écrits de Sagesse, même traduits par la Septante ? De plus, une telle conception a-t-elle un jour vraiment existé chez les chrétiens des premières générations sinon comme position déviante ? S’il est vrai que Dreyfus veut parfois trop prouver, la position réductrice de Boismard n’est pas pour autant représentative de l’exégèse d’aujourd’hui. Au fond, il semblerait que des questions comme : « Jésus est-il Dieu ? » ou « Jésus savait-il qu’il était Dieu ? » relèvent d’une option fondamentale (précompréhension) pour tout chercheur. La conception que l’on se fait du Christ commanderait l’interprétation que l’on fait des textes de l’Écriture. Précompréhension clairement assumée de Dreyfus (p. 11-14) alors que c’est moins évident chez Boismard… « L’insistance de ces documents du magistère sur la scientia visionis du Christ n’est pas une résistance au progrès de la science. Il s’agit plutôt d’une option, qui précède toute recherche exégétique et qui l’oriente. La question de la conscience du Christ se pose différemment, selon que l’on prend comme point de départ la foi dans le Dieu-homme, dans le Verbe fait homme, ou que, d’emblée, on considère Jésus comme un simple homme ayant une relation privilégiée avec Dieu… L’un des plus précieux résultats du débat de ces deux derniers siècles réside dans le fait qu’il soit devenu évident à que point les présupposés du Nouveau Testament coïncident pour l’essentiel avec ceux de la christologie des grands conciles » (18). 40. @ L’Instrumentum Laboris va dans le même sens que F. Dreyfus. « La question n’est pas tant si la vision patristique peut être maintenue, mais bien plutôt si celle de S. Jean, de S. Paul et même des évangiles synoptiques le peut encore être » (Instr. Lab. 1, 1). 41. @ Pie XI et Pie XII replacent le mystère de la conscience et de la science humaines du Christ dans la perspective de l’amour infini du Rédempteur. « Que si, à cause de nos péchés futurs, mais prévus, l’âme du Christ devint triste jusqu’à la mort, elle a, sans nul doute, recueilli quelque consolation, par prévision aussi, de nos actes de réparation alors « qu’un Ange venant du ciel lui apparut » (Lc, 22, 43), pour consoler son cœur accablé de dégoût et d’angoisse » (Pie XI, Miserentissimus Redemptor, AAS 20 (1928) 173-174). « C’est dès avant l’origine du monde que le Fils unique de Dieu nous a embrassés de sa connaissance éternelle et infinie et de son amour sans fin. Et c’est afin de manifester cet amour d’une manière visible et vraiment admirable qu’il s’est uni notre nature dans l’unité de sa personne ; faisant ainsi – comme le remarquait avec une certaine candeur Maxime de Turin - que, « dans le Christ, c’est notre chair qui nous aime » (Serm. 29, PL, 57, 594). Une telle connaissance tout aimante dont le divin Sauveur nous a poursuivis dès le premier instant de son Incarnation dépasse l’effort le plus ardent de tout esprit humain : par la vision bienheureuse dont il jouissait déjà, à peine conçu dans le sein de sa divine Mère, il se rend constamment et perpétuellement présents tous les membres de son Corps mystique, et il les embrasse de son amour rédempteur. O admirable condescendance envers nous de la divine tendresse ! Et dessein inconcevable de l’immense charité ! Dans la crèche, sur la croix, dans la gloire éternelle du Père, le Christ connaît et se tient unis tous les membres de son Eglise, d’une façon infiniment plus claire et plus aimante qu’une mère ne fait de son enfant pressé sur son sein, et que chacun ne se connaît et ne s’aime soi-même » (Pie XII, Mystici Corporis, AAS 35, 1943, 230. Traduction : Maison de la Bonne Presse, Paris, p. 42. Cf. traduction partielle dans D 3812). « Le cœur est en outre le symbole de cette ardente charité qui, infuse dans le Christ, anime sa volonté humaine et dont l’acte est dirigé et éclairé par les deux sciences, toutes deux parfaites, la science de vision béatifique et la science infuse » (Pie XII, Haurietis Aquas, AAS 48 (1956) 327-328. Cf. D 3924). L’omniscience du Christ n’est plus seulement envisagée théoriquement, pour elle-même, mais concrètement, appliquée à l’ensemble du Corps mystique, à chacun de nous personnellement. De plus, elle est reliée profondément à l’amour rédempteur. C’est l’amour rédempteur qui implique la connaissance de chaque être humain (19). L’application 42. @ Les limites du « principe de perfection ». Non sans raison, on a accusé les anciens d’avoir, sans un discernement suffisant, appliqué à la science du Christ un principe de « perfection », emprunté à la philosophie grecque. Ils raisonnaient comme si, d’emblée, il convenait d’accorder à sa « conscience » toutes les perfections possibles. Dès lors, il devenait malaisé de concevoir une quelconque limitation de sa science en ce qui concernait tout ce qui est et sera connaissable à l’esprit humain, ainsi que, souvent aussi, d’admettre un authentique développement progressif de la connaissance de son mystère. Probablement aurait-il fallu mieux distinguer entre un principe de « plénitude » et un principe de « perfection ». Le premier acte de la conscience du Christ impliquait une « plénitude » de la part de Celui qui entrait dans le monde, étant lui-même « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14). Mais cette plénitude ne signifie nullement qu’il n’eût plus rien à apprendre : la Lettre aux Hébreux énonce, en tout cas, le principe complémentaire que, tout Fils qu’il était, il dut être rendu « parfait » (He 5, 9) par une authentique expérience de la douloureuse condition humaine. Pour ce qui est de saint Thomas d’Aquin, voir ST, IIIa, Qu 10, art 1, 3 : « tout ce qui convient au Fils de Dieu par nature convient au Fils de l’homme par grâce ». Saint Thomas fait cependant déjà une utilisation limitée du principe de perfection. Il en « restreint le champ d’application à l’économie du salut ». J.P. Torrell, Le Verbe incarné, T II, Cerf, Paris, 2002, « La science du Christ », note 62, p. 349-351 ; Le Christ en ses mystères, La vie et l’œuvre de Jésus selon saint Thomas d’Aquin, T.1, Desclée, Paris, 1999, p. 138-149. 1) Jésus de Nazareth @ La conscience humaine du Christ est, comme telle, une question moderne. « La notion de conscience n’apparaît pas explicitement dans le texte de saint Thomas et, à vrai dire, c’est une notion plus moderne. Le mot conscience connote une connaissance essentiellement expérimentale et sentie (par réversion sur les actes) ; c’est là une connaissance obscure et qui d’elle-même est inexprimable en concepts, et qui, bien entendu, n’atteint pas non plus l’essence de l’âme. Quand elle peut s’exprimer en concepts, c’est par réflexion sur elle de l’intellect conceptualisant » (J. MARITAIN, De la grâce et de l’humanité de Jésus, p. 120). 2) Le Fils Unique du Père - Vrai homme 45. @ Que penser de la critique de Rahner par Dreyfus ? Dans son célèbre livre : Jésus savait-il qu’il était Dieu (20), le P. F. Dreyfus présente la position de K. Rahner et dit qu’elle « semble revenir à la science d’union d’Alexandre de Hales » que Saint Thomas rejette en ST, IIIa, Qu 9, art. 1, 3° objection. Il semble cependant, à la lecture de saint Thomas et du commentaire du P. Torrell, que les problématiques de Rahner et d’A. de Hales sont différentes. On ne peut donc pas se baser sur ce texte de saint Thomas pour rejeter la position de Rahner. Plus généralement, Rahner prétend que sa position se base sur « l’axiome » « d’une métaphysique thomiste de la connaissance : l’être et la conscience sont des moments d’une seule réalité » (21). Pour une confrontation avec un thomisme plus classique, cf. la présentation et la critique de la position de Rahner dans la Synthèse de J. H. NICOLAS (22). On peut dire que l’accord entre Rahner et Nicolas est bien exprimé ainsi : « L’idée de la corrélation « être-conscience » est extrêmement riche pour la christologie, et se fonde sur une vue métaphysique profonde et importante : l’être est intelligible dans la mesure où il est, et il est intelligent dans la mesure où il est intelligible en acte. L’intelligence n’est pas une perfection surajoutée à l’être, elle apparaît à partir d’un certain niveau d’actualité (l’immatérialité) et ne cesse ensuite de devenir plus parfaite mesure qu’on s’élève dans l’être. Au sommet, l’Etre absolu s’identifie purement et simplement avec l’Intelligible absolu, avec la Pensée absolue. On peut en déduire, en effet, que cet Homme qui est le Verbe incarné doit avoir pleinement conscience de ce qu’il est : ce n’est pas pour lui un mieux-être, c’est une exigence existentielle » (23). Rahner et Nicolas diffèrent cependant en ce que le premier affirme une identité entre la conscience de l’union (vision immédiate) et l’Union hypostatique elle-même, tandis que pour le second la vision immédiate est une conséquence de l’Union hypostatique, l’être précédant logiquement la conscience. « Une union hypostatique seulement au niveau de l’être nu (ontique), et pas au niveau de la conscience est une impossibilité métaphysique » (24). Cette formule de Rahner est donc recevable pour un thomiste même s’il n’admet pas l’ensemble des positions du théologien allemand. Le lien entre l’affirmation de la divinité du Christ et l’affirmation que le Christ a eu conscience de sa divinité est donc plus étroit que ne le dit Dreyfus (25). Un Jésus qui serait Dieu et qui ne le saurait pas impliquerait bien une contradiction dans la structure de l’Homme-Dieu… 47. @ La mise en évidence de la science acquise chez les médiévaux. Cf. J.P. Torrell, Le Verbe incarné, T II, p. 430- 439. La réflexion médiévale est marquée par une christologie descendante. La science divine du Christ ne fait plus aucun doute depuis Nicée. Les médiévaux exploreront la science humaine du Christ. Celle-ci est d’abord vue comme science d’en haut (vision immédiate et science infuse) en vertu de la participation pleine de l’humanité du Christ à sa divinité. La prise en compte d’une science acquise sera difficile, à rebours de notre mentalité moderne qui tient celle-ci pour évidente alors que la vision immédiate et la science infuse posent problème. La mise en valeur d’une science acquise du Christ est une avancée de saint Thomas d’Aquin lui-même. (ST, IIIa, Qu 12). Selon lui, cependant, le Christ a connu par science acquise tout ce qui est connaissable par l’intellect agent ; d’où ce que nous jugeons aujourd’hui comme des exagérations possibles (J.P. TORRELL, Le Verbe incarné, II, note 82). Comment penser l’ignorance dans la vie du Christ ? Qui dit science acquise dit « nescience » ou ignorance non blâmable chez Jésus ; Jésus qui, dans l’évangile, interroge, apprend, s’étonne… La mise en valeur tardive (26) de la science acquise du Christ est sans doute liée à la difficulté de concevoir une ignorance qui n’est pas liée au péché. Pour les pères, notamment à la suite de saint Augustin, l’ignorance est vue le plus souvent comme blâmable, conséquence et source du péché, liée à notre état de nature déchue (cf. Instr Laboris 1, 1). On conçoit difficilement une ignorance moralement neutre, une ignorance non blâmable qui ne menace pas la dignité du Christ en particulier comme révélateur et rédempteur… dans la ligne de Lc, 2, 52 : Jésus « grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes ». Les contemporains ont beaucoup développé l’ancrage de Jésus de Nazareth dans l’histoire humaine. Ainsi par exemple, Bruno Forte : « On peut donc affirmer que l’histoire de Jésus a été marquée, comme toute histoire humaine, par la progression vers une conscience plus claire de soi, des autres et de Dieu. Cette croissance intérieure aurait été alimentée d’une part par un dialogue intime, unique et exclusif, avec le Père, et d’autre part par la relation quotidienne avec les hommes (à commencer par Marie sa mère) et par la connaissance des Ecritures, base de la formation d’un jeune juif » (B. FORTE, Jésus de Nazareth. Histoire de Dieu, Dieu de l’histoire. Paris, Cerf, 1984, 193). - …mais non pur homme 50. @ CEC 473 cite Grégoire et Maxime. « Ce qu’il a donc connu en elle « La nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu » (MAXIME LE CONFESSEUR, Qu. Dub. 66). 51. @ La science du Christ à Constantinople III. Distinction de la science divine et de la science humaine du Christ en marge du concile de Constantinople III essentiellement consacré à la question des deux volontés. La distinction entre science humaine et science divine est simplement posée dans le prolongement de celle des deux volontés, mais le concile ne s’est pas arrêté spécialement sur cette question. Saint Thomas d’Aquin dit en ST IIIa, qu. 9, a. 1, c : « Or rien de ce qui est naturel n’a fait défaut au Christ car, nous l’avons dit, il a pris la totalité de la nature humaine. C’est pourquoi le sixième concile Theodosii haeretici Alexandrini de tomo ab eodem scripto Theodorae Augustae : reliquum est, ut una sit operatio ex utrisque deifica, quoniam & unius esse & ejusdem dicimus Deo decibilia miracula, & naturales omnes, atque irreprehensibiles passiones. Et post pauca : Et unam esse eamdemque unius domini nostri Jesu Christi, & Deo dignam sapientiam, scientiamque omnium, & cognitionem secundum utrumque, id est, secundum ejus divinitatem, & secundum ejus humanitatem, quia & unam operationem confitemur Deo dignam, sicut superius dictum est. « Du tome de l’hérétique Théodose d’Alexandrie écrit par lui-même à l’impératrice Théodora : Il reste qu’il y a une seule opération déifique qui provient de l’une et l’autre « Si en effet, il y a une substance et une nature du Verbe de Dieu incarné, alors, il y a, sans aucun doute aussi une volonté et une opération, et assurément une sagesse et une science de l’une et l’autre Inversement, selon la même logique, la position catholique reconnaîtra qu’il y en a deux. 52. @ Jn 3, 13. « Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme » (traduction liturgique). La BJ traduit semblablement. Osty : « Et nul n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est au ciel » (Osty signale que « qui est au ciel » est omis par certains manuscrits). Même option chez E. DELEBECQUE, op. cit. et dans le VTB, article « ciel » de Jean-Marie Fenasse et Jacques Guillet. Selon A. Feuillet (« La science de vision de Jésus et les évangiles », Doctor communis 1983, 165), l’omission est « trop exclusivement égyptienne » et la lectio difficilior était suivie par Lagrange, Schnackenburg, RE Brown. 53. @ « De ta petite main… tu soutenais le monde et lui donnais la vie » (Thérèse de l’Enfant Jésus). Un transfert symbolique certes légitime : en vertu de la communication des idiomes. C’est l’unique personne du Verbe qui soutient le monde et connaît Thérèse. Mais, si en vertu de sa science (passive) de vision, c’est dans son âme humaine qu’il connaissait Thérèse, c’est l’action créatrice de sa nature divine (mettant en œuvre sa science créatrice) qui soutenait le monde et lui donnait la vie (sa science de vision lui permettait seulement d’en être passivement conscient dans son âme humaine). Le transfert est d’ordre symbolique puisque la « main » de l’Enfant symbolise ici cette action divine. Thérèse distinguait bien les deux plans, car son texte comporte un point avant « Et tu pensais à moi, mon petit Roi ». - …Jésus était conscient de sa divinité 56. @ Un beau texte d’Augustin. Sermon 349, 5-6. PL 39, 1531-1532. « L’aveugle criait tandis que le Christ passait […] Jésus s’arrêta, l’appela et lui dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ? […] Si nous vivons comme il faut, notre vie criera vers le Christ. Il s’arrêtera, lui, l’immobile. Il y a ici tout un symbole. Il passait, quand l’aveugle criait ; mais, quand il le guérit, il s’arrêta […]. Quel est ce passage du Christ ? Tout ce qu’il a accompli pour nous dans le temps, voilà son passage. Il naquit […], grandit […], fatigué il dormit […], il mangea et il but […]. Finalement il fut capturé, enchaîné, flagellé, couronné d’épines, souffleté, couvert de crachats, suspendu au bois, tué, percé de la lance et il ressuscita du tombeau : jusque-là il ne faisait que passer. Mais, monté au ciel, il siège à la droite du Père : il s’est immobilisé. Crie de toutes tes forces : tout de suite il t’illumine. Car, du fait même que le Verbe était auprès de Dieu, il était de toutes façons immobile, car il était immuable. Le Verbe était Dieu, mais le Verbe s’est fait chair. La chair en passant a fait quantité de choses, et elle a passé : le Verbe lui demeura immobile. Du fait que le Verbe en l’assumant rendit honneur à la chair, le « cœur » est illuminé par le Verbe lui-même. Revêts-toi du Verbe, car qu’est-ce que la chair, sinon ce qu’est la tienne. C’est pour que dans le Christ soit honorée la chair, que le Verbe s’est fait chair et qu’il habita parmi nous. » 57. @ Selon saint Augustin, en la personne de Jésus de Nazareth, c’est le cœur de l’homme qui recevait directement sa lumière du Verbe. Ce qui ne veut certes pas dire « exclusivement ». Augustin se place ici du point de vue de l’union hypostatique, qui unit les deux natures dans la personne du Verbe. Du point de vue de la nature humaine prise isolément, aujourd’hui tout le monde admet l’existence d’une science expérimentale, commune au Christ et à nous. C’est par elle que le CEC 472 commence son exposé. Selon saint Thomas, l’intégrité de la nature humaine dans le Christ exigeait qu’à côté de l’illumination augustinienne provenant directement du Verbe lui-même, la source naturelle de lumière que constitue « l’intellect agent » de l’âme humaine remplisse son office de façon permanente. Sous peine de quoi le Christ n’aurait pas été un vrai homme. Cf. ST, IIIa, Qu 9, art. 4. 58. @ Le Cœur de Jésus illuminé par le Verbe chez Ubertin de Casale (1305). Il y avait là plus qu’une figure de style. Dans la théologie du Cœur de Jésus telle qu’on en trouve déjà l’expression achevée chez ce même Ubertin, ce Cœur se présente en effet comme le lieu d’une incessante présence de Jésus à son propre mystère d’amour et de douleur. Vivant parmi les hommes toujours parfaitement immergé en ce lieu solaire du cœur, le Verbe incarné “quant à la perfection de l’acte [...] s’est tenu dans un acte immobile depuis l’instant de sa conception jusqu’à son mortel trépas”. Vertu émanant du Dieu éternel, dont la plénitude d’être et d’amour ne connaît ni accroissement ni déclin, la vertu de la Passion de Jésus rayonne donc sur nous, de toute la vie de Jésus, avec la même imperturbable stabilité que ce soleil victorieux dont Josué avait obtenu l’arrêt dans la vallée de Gabaôn : “De même que le soleil au-dessus de Gabaôn n’a pas bougé, l’amoureuse douleur du Cœur de Jésus n’a pas été interrompue [...]. Ce soleil béni s’est arrêté au milieu du ciel, c’est-à-dire dans l’immense capacité du Cœur de Jésus et de son inestimable amour, et il ne s’est pas hâté de se coucher durant l’espace d’un jour; ainsi pouvons-nous bénir Jésus de n’avoir pas voulu interrompre cet acte spirituel durant tout le cours de sa vie. Ni avant, ni après, il n’y eut jour aussi long, car, dans toute la panoplie des créatures, on ne peut trouver douleur ni amour d’une telle immensité, lumière ou vertu [...] La ferme constance de cet amour et de cette douleur trouve sa figure dans l’œuvre du second jour, où il fut dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux» (Gn 1, 6), car le firmament immobile, c’est son Cœur au milieu de ces eaux qui lui entrèrent jusqu’à l’âme (Ps 68, 2). » (UBERTIN DE CASALE, Arbor vitae crucifixae Jesu, Turin, 1961, I, c. 9 (=12), p. 44) En définitive, la Passion du Christ est une et indivisible de l’indivisibilité même d’un amour perpétuellement brûlant dans ce Cœur du Rédempteur, dont toute la vie fut, au sein même de l’amertume qui le submergeait, comme un seul acte ininterrompu d’ardente charité. 59. @ Un texte d’Augustin mis en lumière dans l’Instrumentum Laboris. Exhumé par Sesboüé ou Schönborn lui-même dans le texte passé inaperçu de l’instrumentum laboris de la CTI, Instru. Lab ; 1, 1. Ce texte, qui n’a pu être poussé à son dernier stade de précision, introduit d’ailleurs le second texte d’Augustin, cité à la suite, d’une façon qui certes manifeste la cohérence de l’enseignement d’Augustin avec celui d’Origène et de Thomas, mais pourrait laisser croire que, là encore, le « directement » du texte de la CTI signifiait « exclusivement » dans tous les domaines (alors qu’Augustin ne se préoccupe ici que du domaine religieux) - Même l’éclaircissement qu’apporte sur la science expérimentale la suite du document (p.84) n’est pas entièrement satisfaisant. En rapportant la pensée thomiste, il oublie une nuance importante : selon Thomas, le Christ n’a pas refusé toute sa vie de prêter l’oreille aux discours de doctrine d’autrui : il y a montré une perméabilité mesurée à partir de l’âge où il a été capable d’en contrôler l’exactitude de par sa propre expérience (IIIa, Qu 12, art 3, ad 3 um). - Il reste qu’en ce qui concerne la session de l’enfant Jésus parmi les doctes, Origène, Augustin et Thomas sont d’accord, c’est en docteur lui-même que l’enfant Jésus siégeait au milieu de cet aréopage de savants – ce qui semble d’ailleurs correspondre à l’intention du récit de Luc lui-même. a) La marche sur l’eau : « c’est Moi » b) La fête des tentes : « Moi, Je suis » - … car il « voit » le Père 65. @ Saint Jean utilise avec précision les temps grammaticaux dans un perspective théologique. L’évangéliste veut distinguer sans les séparer les différents plans d’expression de la Personne du Christ. Contrairement à Balthasar et à une certaine tendance de l’exégèse qui interprètent cela comme une confusion des plans entre le Christ pré-pascal et le Christ post-pascal. Parlant de l’encyclique Mystici Corporis, Balthasar affirme : « Cette christologie commet la faute de ne pas distinguer suffisamment à cet égard le status exinanitionis (statut d’abaissement) et le status exaltationis (statut d’exaltation), ce que pouvait certes favoriser la tendance de la christologie johannique qui fait se refléter l’un dans l’autre les deux status, sans les identifier simplement et sans méconnaître que pour le premier le concept de la mission du Père reste dominant » (H. URS VON BALTHASAR, La Dramatique divine. II. Les personnes du drame. 2. Les personnes dans le Christ, Lethielleux, Paris, 1988, 142). L’auteur n’hésite pas à parler ailleurs d’une « tendance biblique qui s’accentue de Paul et Marc, en passant par Matthieu et Luc, à Jean où Jésus apparaît comme ‘omniscient’ » (p. 139). 66. @ La forme du parfait chez Jean. E. DELEBECQUE, Evangile de Jean, Paris, Gabalda, 1987, 52. Cf. A. FEUILLET, « La science de vision de Jésus dans les évangiles », Doctor communis 1983, 169 qui renvoyait déjà à la Grammaire biblique de F. M. ABEL, 1927, p. 257, n. 55. 67. @ Les développements du II° millénaire sur la science de vision (27). « S’il est de foi… que Jésus a eu une science humaine et même a exercé cette science, la distinction entre science de vision, science infuse, science acquise n’est qu’une précision ou une déduction du dogme et ne relève que subsidiairement de la foi : la science de vision à titre de certitude théologique, proche de la foi…, la science acquise, à titre de vérité communément admise qu’on ne saurait nier sans témérité ; la science infuse à titre d’opinion plus probable et d’ailleurs exposée diversement » (A. MICHEL, DTC, T 14, 2, col. 1651). La vision immédiate est aujourd’hui contestée. Est-elle une donnée de foi ? Selon J. P. Torrell, l’objection principale à la synthèse thomasienne ne vient pas de quelque défaut dans la logique du raisonnement. Plus radicalement, la question à poser à propos de la vision bienheureuse n’est pas d’abord quid sit mais an sit (28). Bien que « l’existence de la vision béatifique dans le Christ durant sa vie terrestre ne se trouve explicitement affirmée ni par l’Ecriture ni par les Pères » (29), cela ne signifie pas qu’elle ne s’y trouve pas implicitement affirmée. La question est de savoir si en écartant la vision immédiate et en la remplaçant simplement par une « lumière christique » (J.P. Torrell), on rendra mieux compte de la profondeur du mystère et des affirmations scripturaires et patristiques… Saint Thomas d’Aquin « considérait avec tous ses contemporains que la vision bienheureuse du Christ s’imposait à lui comme un donné de foi » à laquelle, selon J.P. Torrell, le reste de l’édifice du maître était suspendu, notamment l’existence d’une science infuse (30). C’est pourquoi saint Thomas ne cherche qu’à montrer la convenance de la science de vision en ST IIIa, Qu 9, art 2, réponse (31). Aujourd’hui où la science de vision n’est plus évidemment admise comme un donné de foi, nos contemporains s’efforcent de prouver, là où saint Thomas n’en manifestait pas le besoin. Ainsi, K. Rahner s’est-il efforcé de montrer que la vision immédiate est une conséquence de l’union hypostatique, à partir de l’axiome métaphysique de la correspondance réciproque entre l’ordre de l’être et celui de la conscience : « l’être et la conscience sont des moments d’une seule et même réalité, qui se conditionnent réciproquement ; un être est donc d’autant plus conscient qu’il a d’être ou qu’il est être ». (K. Rahner, « Considération dogmatique sur la psychologie du Christ » dans l’ouvrage collectif Exégèse et dogmatique, DDB, Paris, 1966, p. 199). « En d’autres termes, une union hypostatique seulement au niveau de l’être nu (ontique), et pas au niveau de la conscience est une impossibilité métaphysique » (p. 200. Cf. p. 196-201). Si Jésus est le Verbe, il a donc conscience humaine d’être le Verbe. Or l’être de Jésus, l’union hypostatique est le niveau d’être le plus haut que puisse jamais atteindre une nature humaine, au-dessus même de l’union définitive des bienheureux avec Dieu ; il s’agit là d’une union définitive de la nature humaine et de la nature divine dans la Personne du Verbe dès le premier instant de la conception de Jésus. La conscience de Jésus doit donc être le niveau de conscience le plus haut que puisse jamais atteindre une nature humaine. Ce niveau de conscience est de l’ordre de la vision directe et immédiate de Dieu, vision unique qui dépasse bien sûr en perfection celle dont jouissent les bienheureux mais qui ne saurait en tout cas lui être inférieure. De même chez Maritain : « Rappelons-nous que la vision béatifique n’a pas été donnée au Christ comme le fruit d’un mérite précédemment acquis. Elle lui a été donnée du premier coup, comme une exigence de l’union hypostatique, et, pour ainsi dire, comme un cadeau de celle-ci. Du moment que le Verbe s’incarne, il est nécessaire que sa nature humaine participe à la déité au souverain degré possible, bref qu’elle soit élevée à l’état de comprehensor, c’est-à-dire qu’elle voie Dieu » ( J. MARITAIN, De la Grâce et de l’humanité de Jésus, p. 73). On peut aussi montrer la nécessité de la vision immédiate en partant de la plénitude de grâce dans le Christ affirmée en Jn 1, 14 (32). 68. @ Notre invincible tendance à vouloir résoudre l’énigme « psychologique » que constitue la « conscience » du Dieu fait homme. “Il est tout aussi ridicule qu’irrespectueux de se demander quelle impression peut éprouver celui qui est un Dieu incarné”. « It is indeed both ridiculous and irreverent to ask what it feels like to be God incarnate ! » E. MASCALL, Christ, the Christian and the Church, Londres, 1946, cité par L. BOUYER, Le Fils éternel, Cerf, Paris, 1974, 465 et par H. URS VON BALTHASAR, La Dramatique divine, p. 132. E. Mascall revient sur la question dans : Théologie de l’avenir, Desclée, Paris, 1970 : « Il est certainement puéril de se demander quel effet cela peut faire d’être le Dieu incarné » (p. 110). Dans Le Fils éternel, p. 453-468, Louis Bouyer se livre à une critique de ce qu’il appelle les « christologies psychologiques », allusion aux débats christologiques parfois très pointus chez des théologiens du XX° siècle. Comme l’union hypostatique au plan ontologique, la conscience du Christ au plan psychologique nous restera toujours largement inaccessible. En ce sens, le père Bouyer à raison de dénoncer une prétention indue de la raison humaine à épuiser le mystère. Cela dit, il serait excessif de négliger complètement la valeur des débats soulevés par les théologiens en question, tels Diepen et Nicolas. Il ne s'agit pas d'impression mais de psychologie humaine quand on est le Verbe incarné, la question n'est pas oiseuse, il suffit de lire de près les débat entre Galtier et Parente pour en juger plus respectueusement. Sur ce point, cf. J. ALFARO dans Mysterium salutis III/11, Paris, Cerf, 1975, ch. 7, p. 241-322 (296-298) qui présente fort bien le rapport entre conscience humaine et vision de l'essence divine dans l'âme humaine de Jésus. 3) Rempli de l’Esprit Saint Le Baptême au Jourdain La lecture des Ecritures 69. @ La « science infuse » dans la tradition théologique. K. Rahner, tout en ayant fermement fondé la vision immédiate, ne voit pas la nécessité d’une science infuse dans le Christ. La question est alors de savoir si l’intimité immédiate du Christ avec Dieu peut être conceptuellement objectivée, directement par la science acquise, sans la médiation d’une science infuse, à l’image de l’homme qui peut laborieusement objectiver conceptuellement sa propre conscience implicite d’être homme. S’il est vrai que la vision béatifique est comme telle intraduisible conceptuellement, alors une lumière infuse est nécessaire pour l’œuvre de la Révélation et du salut. K. RAHNER, « Considération dogmatique sur la psychologie du Christ » dans l’ouvrage collectif Exégèse et dogmatique, DDB, Paris, 1966, p. 205-207. Voir la réaction de L. MALEVEZ, « Le Christ et la foi », NRT 88 (1966), p. 1027-1028. Cf. J. MARITAIN, De la grâce de l’humanité de Jésus, DDB, Bruges, 1967, p. 76. Opinion du P. Margelidon, op : « Pour la science infuse je suis plus embarrassé, je crois qu'il faut la maintenir mais saint Thomas lui accorde trop et Maritain une place démesurée. Sa distinction supra/sub (33) ne me satisfait pas dans le cas du Christ (il faudrait en préciser les termes). La vision chez beaucoup de thomistes (même J-H. Nicolas) est extatique, ineffable, inexprimable ce que saint Thomas ne dit jamais. On comprend que pour eux la science infuse s'impose afin que le Christ puisse transmettre les vérités révélées ce qui ne me semble pas être la raison fondamentale. Elle lui est nécessaire pour sa mission dans l'ordre de la connaissance surnaturelle mais humaine de toutes les réalités créées qu'il rencontrait ». Science infuse du Christ et science d’Adam. Selon saint Thomas, (ST, Ia, Qu 94, art. 3), Adam intègre possédait un science infuse (mais évidemment pas la vision béatifique Ia, Qu 94, 1). Peut-on faire un rapprochement entre science infuse d’Adam et science infuse du Christ ? La « science » prend place parmi les quatre « dons préternaturels » que l’on attribue traditionnellement à Adam intègre. Le magistère est peu explicite sur ce quatrième don. Tout juste trouve-t-on une mention de « l’ignorance » dans le Catéchisme (CEC 405), à côté des trois autres maux de l’existence qui sont les conséquences du péché originel (concupiscence, souffrance et mort). Rappelons que nous n’avons pas un accès direct à la condition d’Adam intègre. Ce n’est que par la lumière du Christ sur le récit de Gn et sur les quatre maux de l’existence (que nous ne connaissons que trop !), que nous pouvons aborder a contrario les quatre dons préternaturels. La description concrète de ces dons reste donc pour une large part objet d’hypothèse, ce qui n’empêche pas l’existence d’une longue tradition théologique sur ce sujet. « Errare humanum est » dit le proverbe. C’est parce que la difficulté d’exercice de l’intelligence et l’erreur propres à la nature humaine peuvent avoir des conséquences dommageables à la conduite d’une vie conforme au plan de Dieu, qu’un don préternaturel de « science » a été accordé par Dieu à nos premiers parents. Ce don préternaturel perfectionne l’homme dans la ligne de sa nature propre et le prépare à la grâce et à la vie divine que le Seigneur lui destine. L’homme a en effet besoin que soit notamment affermie en lui la connaissance religieuse (et métaphysique) du monde, de sa vocation propre et de Dieu. Le don de « science » s’apparente de ce fait plus à la « sagesse » biblique qu’à la connaissance scientifique au sens moderne du mot. Selon saint Thomas d’Aquin, nos premiers parents diffèrent des autres en ce qu’ils sont les premiers de la série humaine. C’est parce qu’il est le patriarche de l’humanité que la science d’Adam était plus parfaite que celle de ses enfants (Ia, Qu 101). Adam « en sa qualité de premier homme » avait mission d’« instruire et gouverner les autres ». Pour « gouverner sa vie et celle des autres », selon le plan de Dieu, il avait besoin d’une connaissance tout à la fois « naturelle » et « surnaturelle » (Ia, Qu 94, 3). On peut faire ici un rapprochement entre le rôle du Christ comme Révélateur et le rôle d’Adam comme premier instituteur de l’humanité. Bien que saint Thomas exclut de la science d’Adam ce qu’il est inutile de savoir, (« par exemple les pensées des hommes, les futurs contingents et certaines données singulières comme : combien de cailloux se trouvent dans le fleuve »), on peut trouver que saint Thomas fait une utilisation trop généreuse du principe de perfection : « Selon l’ordre naturel, le parfait précède l’imparfait… ». De ce fait, « … le premier homme fut établi par Dieu dans la possession de la science concernant toutes les choses dont l’homme peut être instruit » (Ia, Qu 94, 3). De même qu’il est opportun de mettre en lumière la connaissance acquise du Christ et de limiter sa science infuse, mieux que ne l’ont fait les anciens, un mouvement analogue serait à opérer chez Adam. La notion de finitude et de marche vers un accomplissement seraient importantes à intégrer. Cf. Les origines de l’homme, texte, traduction et notes de ST, Ia, Qu 90-102, Cerf, Paris, 1998. Conclusion : L’unité de la conscience du Christ 71. @ Unité de la conscience du Christ et distinction des plans. La pensée contemporaine va chercher à mieux penser l’unité de la conscience du Christ tout en développant ce que saint Thomas n’avait fait qu’amorcer en découvrant une science acquise dans le Christ. La psychologie contemporaine, attentive à la complexité des multiples dimensions de la conscience humaine, nous invite à dépasser une conception binaire selon laquelle une chose est soit connue, soit inconnue. Une chose peut-être connue à un certain niveau et ignorée à un autre niveau. On peut par exemple avoir conscience implicite d’être homme sans en avoir une conscience réfléchie et explicitée, cette dernière étant du reste sujette à un approfondissement jamais achevé. Cf. K. RAHNER, « Considération dogmatique sur la psychologie du Christ », p. 193-195. C. VON SCHÖNBORN a relevé cet aspect mis en lumière par Rahner en le rapprochant de la distinction augustinienne entre le nosse et le cogitare ("La conscience que Jésus avait de sa mission et de lui-même", Képhas, 12, 2004, 111-114). Nous pouvons alors penser les trois sciences traditionnelles du Christ à des niveaux de profondeur de conscience différents sans être complètement séparés. Nous pouvons ainsi dépasser une conception d’une science à étages qui conduisait en fait à imaginer sur un même plan les 3 sciences du Christ. On avait alors beau jeu de constater combien il était difficile à une science acquise proprement humaine de subsister sous le poids des deux autres… Divers auteurs ont tenté de reprendre l’exposé thomiste en faisant droit à la profondeur de cette conscience, dans la ligne des découvertes modernes. Jacques Maritain, par exemple, distingue entre supra conscient, conscient et subconscient. C. von Schönborn cite aussi M. Scheler, H.E. Hengstenberg, A. Brunner. (Instr. laboris, p. 86). Supraconscience et conscience selon J. Maritain. On peut reformuler la terminologie de Saint Thomas qui situait la science de vision dans « la partie supérieure de l’âme ». Maritain propose de parler dans le Christ du domaine du « supra conscient de l’esprit divinisé par la vision béatifique » (De la grâce et de l’humanité de Jésus, p. 57. Cf. p. 57-64), en relative (non pas totale) autonomie par rapport à la conscience. Ce qui lui permet à la suite de Saint Thomas d’expliquer la mystérieuse coexistence entre la béatitude et la souffrance. (p. 63, note 2. Cf. ST, IIIa, Qu 46, 6 et 8). Ce qui permet aussi de comprendre comment le Christ nous a tous enveloppés de son amour infini dans son supra conscient divinisé, dès sa conception, tandis que sa conscience de viator connaissait un développement propre à un verus homo. (J. Maritain, p. 93, note 1). Science infuse et science acquise. Une science infuse conçue sur le mode de la science angélique est-elle concevable dans une conscience humaine ? Comment comprendre alors le rôle de la connaissance acquise ? J.P. Torrell propose de remplacer science infuse par « lumière » infuse, « lumière christique » (J. P. Torrell, Le Christ en ses mystères, p. 144 ; « Saint Thomas d’Aquin et la science du Christ », p. 408, note 2.), mais est-ce suffisant, dans la mesure où l’auteur ne reconnaît pas de vision immédiate au Christ ? Maritain propose de distinguer d’une science infuse du Christ comprehensor que décrit Saint Thomas, une science infuse du Christ comme viator (J. MARITAIN, De la grâce et de l’humanité de Jésus, p. 97-102.): « non seulement… la science infuse… s’est exercée dans la sphère de l’ici-bas de l’âme du Christ… à mesure que cette sphère elle-même se formait, en même temps que se développait dans l’enfant l’exercice de l’intelligence et de la raison, mais… dans cette sphère de l’ici-bas de l’âme du Christ elle a grandi (de même que la grâce (34) et la charité) et n’a cessé de grandir pendant toute sa vie terrestre. Et à chaque moment de ce développement, elle s’étendait à tout ce que Jésus avait besoin de savoir à ce moment… » (J. MARITAIN, op. cit. p.100-101). Cela permet à l’auteur d’expliquer le logion de l’ignorance (Ibid. p. 100, note 2). Voilà une science infuse qui peut se concilier avec l’idée d’une croissance propre de la conscience de Jésus viator. Il y aurait alors une histoire de l’appropriation par la science acquise de la lumière infuse chez Jésus, autant qu’une croissance de la science infuse elle-même avec en fond la vision de Dieu qui est inépuisable. 3. « Me voici là pour faire, ô Dieu, ta volonté ». 72. @ Le caractère paradoxal de la vie du Christ. Le paradoxe entre Jésus souffrant et bienheureux dont parle Jean Paul II dans NMI, renvoie au paradoxe exprimé par la tradition théologique entre Jésus viator et comprehensor (35). On peut dire que les deux paradoxes se recoupent. Saint Thomas exprime ainsi la condition paradoxale du Christ voyageur-pèlerin et bienheureux (viator et comprehensor) : « Il jouissait donc ainsi de la béatitude quant à ce qui est propre à l’âme. Mais quant au reste, la béatitude lui manquait encore, car son âme était passible, et son corps passible et mortel » (IIIa, Qu 15, 10). Sur le problème posé par la coexistence de la béatitude et de la souffrance, cf. J. P. TORRELL, « Saint Thomas d’Aquin et la science du Christ, une relecture des questions 9-11 de la « Tertia Pars » de la Somme de Théologie » in Saint Thomas au XX° siècle. Actes du colloque du Centenaire de la « Revue Thomiste », 25-28 mars 1993. Toulouse, Editions Saint Paul, Paris, 1994, sous la direction du P. S.T. BONINO, p. 400-401. La vision immédiate du Christ est à la fois supérieure à celle des bienheureux en raison de l’union hypostatique et elle est inférieure parce que le Christ est encore viator. « Aucune personne créée ayant atteint la béatitude ne saurait avoir une vision béatifique dans laquelle elle se connaîtrait elle-même comme Fils éternel et consubstantiel de Dieu le Père. C’est pourquoi la vision béatifique du Christ est singulièrement, autrement intensive et immanente dans son exercice que celle des bienheureux qui l’exercent comme des personnes créées ». « Inversement, tant qu’il a été encore sur cette terre dans ‘la condition d’esclave’ (Phil 2, 7), le Fils de Dieu fait homme a eu une modalité d’exercice de la vision béatifique qui était moins extensive dans son rejaillissement de gloire sur l’ensemble de son être que celle des bienheureux au ciel » (36). Dieu le Père montre à sainte Catherine de Sienne, Docteur de l’Eglise, que, dans les âmes saintes, peuvent être présentes à la fois la joie et la souffrance : « Et l’âme est bienheureuse et souffrante : souffrante pour les péchés du prochain, bienheureuse par l’union et l’affection de la charité qu’elle a reçue en elle. Ceux-là imitent l’Agneau immaculé, mon Fils unique, lequel sur la Croix était bienheureux et souffrant. Souffrant, parce qu’il portait la croix du corps et parce qu’il endurait la souffrance de la croix du désir afin d’expier pour le genre humain. Bienheureux, parce que la nature divine unie à la nature humaine, ne pouvait souffrir et rendait bienheureuse son âme en se révélant à elle sans voile. C’est pourquoi il était à la fois bienheureux et souffrant : sa chair souffrait, mais sa divinité ne pouvait souffrir et non plus son âme en sa partie supérieure, la plus spirituelle » (Le livre des dialogues, Seuil, 1953, ch. 78, p. 252, cité en NMI 27). Ce paradoxe du Christ voyageur et bienheureux (viator et comprehensor), cette coexistence de la joie et de la souffrance dans la conscience du Christ ne constituent nullement une exception. Selon le Père de Lubac, à la suite notamment de saint Augustin, de Pascal et de M. Blondel, le paradoxe est au cœur du mystère du Christ, du mystère chrétien tout entier et même du réel en général. Ainsi, par exemple, le Christ homme, Dieu ; l’Eglise divine et humaine… On pourrait dire que le paradoxe est un principe herméneutique fondamental pour bien appréhender le mystère. « Le paradoxe est paradoxe : il se moque de l’exclusion commune et raisonnable du contre par le pour. Il n’est pourtant pas, comme la dialectique, savant renversement du pour au contre. Il n’est pas non plus seulement le conditionnement de l’un par l’autre. Il est simultanéité de l’un et de l’autre. Il est même quelque chose de plus, - sans quoi, d’ailleurs, il ne serait que la vulgaire contradiction. Il ne pèche pas contre la logique, dont les lois restent inviolables : mais il échappe à son domaine. Il est le pour alimenté par le contre, le contre allant jusqu’à s’identifier au pour, chacun des deux passant dans l’autre sans s’y laisser abolir et continuant à s’opposer à l’autre, mais pour lui donner vigueur » (H. de LUBAC, Paradoxes, 143). Cf. les excellentes remarques d’E. GUIBERT sur la compréhension du mot « paradoxe » : Le Mystère du Christ d’après Henri de Lubac, Paris, Cerf, 2006, 119-122 ; 289 et sv ; 460-462. Voir aussi : J. F. THOMAS, « La vérité du paradoxe », Communio, 1992, 92-109. Un texte de Jean Paul II « Dès le premier instant de son Incarnation » 82. @ La conscience paradoxale du Christ s’exprime particulièrement dans l’événement de la Transfiguration. Nous avons noté comment, chez le père de Lubac, la scène de la Transfiguration pouvait être le point focal de la christologie (Cf. ch 10, @ La Transfiguration point focal de la christologie). Cet événement central dans la vie du Christ, éminemment paradoxal (cf. ch. 12, @ Le caractère paradoxal de la vie du Christ) est comme une « synthèse réelle » que le Christ nous donne lui-même de son mystère (E. GUIBERT, Le Mystère du Christ d’après Henri de Lubac, Paris, Cerf, 2006, 400). Pour H. de Lubac, « l’Incarnation est le Paradoxe suprême » (Paradoxes, 8) et c’est dans la scène de la Transfiguration que se fait la synthèse finale. Parmi les paradoxes révélés par la scène de la Transfiguration, on trouve le lien entre la gloire et la croix. Nous pouvons approfondir ce paradoxe en en scrutant, avec Louis Chardon, la dimension intérieure. Lorsque nous disons que la joie et de la souffrance habitent la conscience du Christ, on peut appliquer à ce mystère la notion de paradoxe mise en évidence par H. de Lubac. Joie et souffrance s’alimentent l’une l’autre dans une coexistence dynamique. « C’est affaire au Fils de Dieu de montrer, en la disposition de son âme, des paradoxes en la nature et en la grâce, dont personne n’est capable que lui » (L. CHARDON, La croix de Jésus, Paris, Cerf, 1937, 75). Constituant, pour ainsi dire, le sommet du dévoilement prépascal de la condition divine de Jésus (comme tel réservé aux trois plus intimes parmi les Douze), la scène de la Transfiguration comporte dans la version de Luc une notation singulière : au plus fort de la métamorphose de Jésus, Moïse et Elie lui « parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem » (Lc 9, 31). L. Chardon, prenant appui sur le latin excessum (départ) qu’il traduit par « excès » déclare : « Il parlait, non de l’excès de sa béatitude, mais de l’excès de ses misères » (51). « Mais voici ce qui est encore plus plein de merveilles quand nous considérons Jésus au milieu de la gloire éclatante du Thabor, abîmé dans l’essence divine et absorbé en la plénitude du bonheur éternel qui fait en toutes ses facultés, tant inférieures que supérieures, un déluge de joies proportionnées à la grandeur du mérite du Fils unique de l’éternité, avoué pour tel par une protestation ineffable du Père céleste ; et néanmoins, au lieu de retenir son esprit arrêté à tant de biens qui portent leurs effets jusque dessus ses vêtements, au contraire, il l’en retire et divertit sa pensée pour envisager de loin les fouets, les épines, les clous et la mort honteuse d’une cruelle croix ». « Les rassasiements de la gloire éternelle ne peuvent étancher la soif qu’il a de souffrir. Il oblige Moïse et Elie de l’entretenir de l’excès qu’il devait accomplir en Jérusalem, comme si tout ce qui était en lui avait obligation de conspirer à la fin de son ministère, sans mettre dans l’exclusion la gloire essentielle et, qui plus est, sa Personne divine, en laquelle la nature humaine n’a été unie que pour la fin de cette union, qui est la réparation de l’homme » (53). Louis Chardon voyait l’expression la plus franche du paradoxe qui habitait l’âme du Christ : à l’instant où le poids de gloire qui sommeillait au fond de son être – ce poids de la vision béatifique du Père – s’extériorisait jusque sur son corps, à cet instant même se manifestait l’antagonisme intérieur de cet autre poids qui inclinait son âme vers la croix ; et c’est de celle-ci qu’il s’entretenait avec les deux grands témoins vétéro-testamentaires de sa divinité. Depuis l’instant de l’Incarnation, par une disposition divine, l’effet béatifiant de la Vision avait été retenu à la pointe de cette âme : maintenant que tout son psychisme y aurait goûté, son écartèlement douloureux, en déduisait Louis Chardon, avait dû par contraste s’en trouver décuplé : « depuis la Transfiguration… après que la partie inférieure Voir : G. Berceville, « Souffrance et sainteté dans La croix de Jésus de Louis Chardon », La Vie Spirituelle, novembre 2006, 599-614. 83. @ Une vision immédiate non béatifiante est-elle possible ? Des théologiens comme K. Rahner proposeront l’idée d’une vision immédiate non béatifiante (37). De même déjà M. Blondel (38). Dans un premier article sur la question, K. Rahner était plus nuancé : « Nous préférons ‘visio immediata’ à ‘visio beata’, parce que cela exprime de façon plus précise et plus prudente le contenu théologiquement vraiment sûr de l’enseignement dont il s’agit ici. En effet, c’est l’immédiateté de la possession divine qui découle des réflexions proposées ici. Il n’est pas nécessaire que cette vision bienheureuse soit toujours ressentie clairement et immédiatement comme béatifiante ; n’est-il pas concevable, en effet, qu’elle puisse, dans certaines situations de ‘viator’, éprouver comme un feu dévorant ? » (39). Selon J. P. TORRELL, à la suite de saint Thomas d’Aquin, si l’on affirme une vision immédiate, ne faut-il pas à dire qu’elle est forcément béatifiante ? (40) Rahner a vu une opposition là où il y a plus justement un paradoxe du Christ qui a été à la fois le plus bienheureux et le plus souffrant des hommes. 84. @ « Depuis le commencement ». Commentaire de saint Thomas d’Aquin. « Il savait depuis le commencement » (Jn 6, 64). Face à cette parole, il y aurait le niveau de compréhension des auditeurs du temps et celui des chrétiens à venir. Jésus pénètre le mystère de la liberté de chacun depuis le commencement. Il peut s’agir du commencement du ministère apostolique ou alors du commencement du livre de la Genèse. C’est la perspective de saint Thomas qui pose ainsi une relation entre la connaissance divine du Verbe éternel et sa connaissance humaine. « Sciebat enim ab initio qui essent credituri, et qui traditurus eum esset. Theophylactus : Volens per hoc nobis Evangelista ostendere quod ante constitutionem mundi omnia cognoscebat ; quod divinitatis erat indicium » (In Joannis evangelium, cap. VI). « Il savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui croiraient et qui était celui qui le livrerait. Théophylacte : L’évangéliste veut nous montrer par là que, avant la constitution du monde, il connaissait toutes choses ; ce qui était un indice de la divinité ». Saint Thomas se réfère à Théophylacte d’Achrida († 1120 – 1126 ?), archevêque et théologien grec. Cf. DS, article Théophylacte. « Et Evangelista volens ostendere quod ab initio mundi omnia cognoverit, dicit : ‘Ab initio noverat Jesus qui essent non credentes, insuper et proditoris malitiam : quo certe monstrabatur deitas. Nam propheta inquit de Deo : ‘Qui sciebat omnia priusquam ipsa fierent (Dan 13, 42)’ ». (Théophylacte : Enarratio in evangelium Joannis, VI, traduction latine du texte grec PG 123, 598AB, p. 1315). « Et l’évangéliste, voulant montrer qu’il connaissait tout depuis le commencement du monde dit : « depuis le commencement, Jésus connaissait quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et en outre la malice du traître : par là est montrée de manière certaine la divinité. En effet, le prophète dit de Dieu : « Toi qui savait toute chose avant qu’elles n’arrivent » (Dan 13, 42) ». Amour, douleur et joie Le paradoxe Sa représentation symbolique - L’image de 1685 88. @ « Dès le premier instant » de l’Incarnation chez sainte Marguerite Marie. « Premier instant » au singulier acquiert ici un sens « métaphysique ». En ce qui concerne le cœur physique, ne coïnciderait avec le biologique que si on pouvait garder quelque chose de la thèse des médiévaux (vg. Thomas) : sans aller jusqu’à dire avec eux que le « principe d’exception » qu’ils appliquaient au Christ voulait que son corps fût dès le premier instant formé en toutes ses parties, serait-il inconcevable que le 1er battement du « cœur » (normalement réservé au début de la 4e semaine) ait été l’inscription biologique du « oui » du Verbe incarné dans sa chair à l’instant où, dès le Fiat de sa mère, il la prit pour « entrer dans le monde ». Si nous sommes d’en bas et lui d’en haut, cela doit bien s’inscrire de quelque manière « au commencement » (cette phrase étant l’interprétation métaphysique que Jean nous donne du récit historique de la conception virginale (nouvel exemple de ce passage à la limite que nous avons si souvent relevé chez saint Jean. De toutes façons, la « loi d’exception » que constitue la conception virginale veut dire au minimum ceci : « concevoir du Saint-Esprit » transcende l’union de deux gamètes dans le corps d’une femme fécondée par son mâle. - Conception Cabrera de Armida 92. @ « Océan d’amertume ». Une similitude d’expression chez Conchita et Marguerite Marie ? [*** Prochainement en ligne ***] Conclusion. NOTES : (1) Cf. CBP 1992, à propos du sens spirituel des Ecritures (Cf. ch 4). (2) Et l’auteur d’ajouter : « Cette conception est, à coup sûr, très séduisante ; mais le progrès de la théologie chrétienne y apportera des corrections considérables… » (J. LEBRETON, Histoire du dogme de la Trinité, T.1, Paris, Beauchesne, 1927, 9° édition, 575-576). Cf. l’ensemble de la note : « La controverse christologique du V° siècle. Saint Cyrille d’Alexandrie, op. cit. 567-576. (3) comme nous ! pourrions-nous rajouter. (4) Cf. @ La mise en évidence de la science acquise chez les médiévaux. (5) L’union hypostatique entraîne chez le Christ une impeccabilité absolue, une radicale impossibilité de faillir qui vient de la grâce d’union. Cf. J. H. NICOLAS, Synthèse Dogmatique, Fribourg, Editions Universitaires, 1985, 410-411. Dans l’intégrité originelle, la faillibilité, caractéristique de l’état de viator, faisait partie de la condition de nos premiers parents. Le don préternaturel de « science » n’excluait donc pas une certaine « nescience », condition de possibilité de la confiance, de la foi en la Parole de Dieu, comme de la confiance possible en la parole du Menteur. (6) François DREYFUS, Jésus savait-il qu’il était Dieu ?, Paris, Le Cerf, 1984, 144p. Avant Propos. (L’ouvrage en est à sa quatrième édition et il a été couronné par l’Académie française). (7) Réponse à Marie-Émile Boismard dans Revue Biblique, 1984, 591-601. (8) Recherches de Science Religieuse, t. 73 (1985), 584-588. (9) Commission théologique internationale, 8 / 12 / 1985 : « La conscience humaine de Jésus », DC, n° 1926, p. 916-921. (10) « La conscience du Christ. Approches historico-théologiques », publié par C. von SCHÖNBORN dans Esprit et Vie, 9 02 1989, p. 81-87. (11) Revue Biblique, 1984, 591-601. (12) « fils de l’homme » est une figure apocalyptique que l’on trouve pour la première fois dans Daniel et dans la littérature intertestamentaire comme par exemple, le livre d’Hénoch ou le IV° Esdras. Appliqué à Jésus, l’expression ne veut pas dire seulement « humain » puisqu’il vient du ciel. Il y a un paradoxe à dire : le Fils de l’homme vient du ciel. C’est la première fois que l’on a une christologie descendante. Cf. Jn 3, 13 : « Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’Homme qui est dans le ciel ». (Nombre de manuscrits et de Pères ajoutent cette finale mise ici en italiques). (13) Sinon une seule fois : « À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde vous dites : “Tu blasphèmes ”, parce que j’ai dit : “Je suis fils de Dieu !” » (Jn, 10, 36). Beaucoup de traductions disent : « le Fils de Dieu » (article plus majuscule). Certes, on peut en discuter puisque le prédicat avec le verbe être ne prend pas l’article. De fait nous maintenons « fils » (avec minuscule), l’expression peut être comprise dans le sens courant où tout croyant du judaïsme pouvait dire : « je suis fils de Dieu ». Il reste cependant que sans que Jésus revendique quoi que ce soit, il se comporte en fils, tellement fils que ses contemporains ne s’y trompent pas. (14) Cf. M. ZERWICK, Graecitas Biblica Novi Testamenti Exemplis illustratur, Romae, 19665, n° 236 p. 78. (15) Cf. Ps 132 (131). (16) « Le Seigneur m’a conçue, prémices de son chemin avant ses œuvres, depuis le début ». Le verbe hébreu traduit ici par « conçue » a été traduit en grec par ktizo (bâtir, fonder, créer), d’où la traduction possible : « Le Seigneur m’a créée… ». La Vulgate dit : « Dominus possedit me : m’a acquise. (17) Boismard, p. 600. Arius s’était déjà appuyé sur une semblable exégèse de Prov 8, 22. (18) Christoph. VON SCHÖNBORN, « La conscience que Jésus avait de sa mission et de lui-même », Képhas, n° 12 (2004) 110-111. (19) L’omniscience du Christ est avant tout « omniscience omnipersonnelle, dans l’amour, au sein du mystère pascal ». (B. DE MARGERIE, « Les sept yeux de l’Agneau, Reprise du dossier sur la science humaine de Jésus avant Pâques », Divus Thomas, LXXXVI (1983), n°1, p. 44). (20) Paris, Cerf, 1984, p. 32. (21) K. Rahner, « Considération dogmatique sur la psychologie du Christ » dans l’ouvrage collectif Exégèse et dogmatique, DDB, Paris, 1966, p. 199. Le thomisme de Rahner est étroitement dépendant de l'école de Louvain, Maréchal en particulier, c'est-à-dire un thomisme relu dans une perspective kantienne. (22) J. H. NICOLAS, Synthèse dogmatique, Fribourg, Editions universitaires, 1985, p. 318-322. (23) J. H. Nicolas, p. 320. (24) Rahner, p. 200. (25) Dreyfus, p. 33-34. (26) Notons cependant le remarquable texte de Cyrille d’Alexandrie : « Or, c’est le propre de l’humanité de progresser en âge et en sagesse, je dirai même en grâce, l’intelligence qui se trouve en chacun se développant, en quelque façon, en même temps que les dimensions du corps. Chez les enfants, elle n’est plus ce qu’elle était au premier âge, et dans la suite elle croît encore. Car il n’était certainement pas impossible ni irréalisable pour le Verbe, puisqu’il est Dieu et né du Père, de grandir dès le berceau le corps qu’il s’était uni, et de l’amener soudain à la croissance parfaite. Et je dirai aussi qu’il lui était aisé et facile de manifester dans l’enfant une sagesse admirable ; mais cela eût peu différé de la magie, et cela eût rompu l’économie de l’incarnation. Car ce mystère s’est accompli sans éclat. Il a donc permis aux lois de l’humanité de garder en lui toute leur valeur » (saint Cyrille d’Alexandrie, PG 75, 1331 B ; SC 97, p. 455-457). (27) Cf. J.P. Torrell, Le Verbe incarné, T II, p. 421- 430. (28) J.P. Torrell, « Saint Thomas d’Aquin et la science du Christ, une relecture des questions 9-11 de la « Tertia Pars » de la Somme de Théologie » dans Saint thomas au XX° siècle. Actes du colloque du Centenaire de la « Revue Thomiste », 25-28 mars 1993. Toulouse, Editions Saint Paul, Paris, 1994, sous la direction du P. S.T. Bonino, p. 400-402. (29) H. BOUËSSE, Le Sauveur du monde, T II, Le mystère de l’Incarnation, Paris, 1953, 375-376. (30) J.P. TORRELL, Le Christ en ses mystères, p. 141. (31) Dans la réponse à la deuxième objection de ce même article, saint Thomas parle cependant de la nécessité (oportuit) d’une « béatitude créée, par laquelle son âme serait établie dans la fin ultime de la nature humaine », outre la « béatitude incréée » que le Christ possède « en vertu de l’union » hypostatique. Il y a là un argument fort en faveur de la vision bienheureuse. (32) Cf. D. OLS, « Plénitude de grâce et vision béatifique. Une voie peu fréquentée pour établir la Vision Béatifique du Christ durant Sa vie terrestre », Studi Tomistici 40 (1991), 315-329. (33) Cf. @ Unité de la conscience du Christ et distinction des plans. (34) L'idée de Maritain selon laquelle le Christ pouvait croître en grâce paraît difficilement acceptable, étant donné la plénitude de grâce impliquée par la grâce d'union. « Si l’humanité du Christ ‘progressait en grâce’ (Lc 2, 52), ce n’était pas pour l’accroissement de la sainteté personnelle de Celui qui, dès le sein de sa mère, est ‘le Saint’ (Lc 1, 35). Le perfectionnement par grâce de son âme et des puissances de celle-ci n’était pas le perfectionnement d’une personne humaine en vue d’atteindre sa fin ultime, car sa nature humaine assumée n’était perfectionnée qu’en vue de l’exercice progressif de son rôle comme instrument de salut. Il s’agissait donc d’un perfectionnement d’ordre purement extensif et instrumental dans les actes de l’œuvre rédemptrice qu’il avait mission d’accomplir comme homme » (J. M. GARRIGUES, « La conscience de soi telle qu’elle était exercée par le Fils de Dieu fait homme », 40). Cf. ST, IIIa, Qu 7, art. 12 ; J. P. TORRELL, Le Verbe incarné, T. II, note 25, p. 321-322. (35) Ici, « compréhension » est utilisé au sens de saisie du bien suprême par opposition à sa simple quête chez l’homme d’ici bas. Ailleurs, lorsque saint Thomas prend « compréhension » en un sens totalisant, il affirme alors que la vision n’est pas une compréhension de l’essence divine : « L’âme du Christ n’était nullement capable de comprendre parfaitement l’essence de Dieu » (ST, IIIa, Qu 10, art. 1). Cf. J. P. TORRELL, Le Verbe incarné, T. II, note 63, 351. (36) J. M. GARRIGUES, « La conscience de soi telle qu’elle était exercée par le Fils de Dieu fait homme », Nova et Vetera, janvier-mars 2004, 47. (37) « Considération dogmatique sur la psychologie du Christ » (Original allemand de 1962) dans l’ouvrage collectif Exégèse et dogmatique, DDB, Paris, 1966, p. 196-197. (38) J. MOUROUX, « Maurice Blondel et la conscience du Christ », in L’homme devant Dieu, Mélanges offerts au Père H. de Lubac, T III, Aubier, Paris, 1964, p. 205. (39) « Problèmes actuels de christologie », Ecrits Théologiques, T. 1, Bruges, DDB, 1959 (Original allemand de 1954), p. 142, note 1. (40) Le Christ en ses mystères. La vie et l’œuvre de Jésus selon saint Thomas d’Aquin, T.1, Desclée, Paris, 1999, p.142. Cf. de même, C. VON SCHÖNBORN, "La conscience que Jésus avait de sa mission et de lui-même", Képhas, 12, 2004, 109. © Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. |